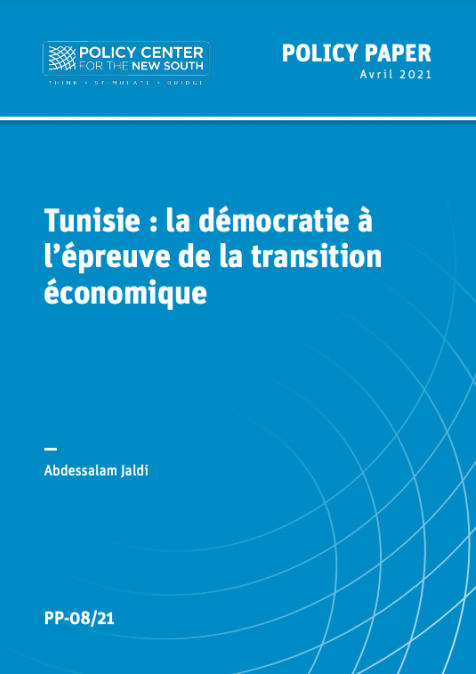Publications /
Opinion
En dépit des progrès sociaux, le Maroc reste confronté à une série de défis. Le chômage persiste à un niveau inacceptable, l’adéquation entre la formation et l’emploi est insatisfaisante, l’accès aux soins est contrarié par maintes contraintes, les disparités territoriales demeurent flagrantes. Pourtant, que de réformes, que de programmes sociaux sont financés depuis des décennies pour couvrir les déficits accumulés par le passé. Beaucoup de ces secteurs névralgiques pour le bien-être du citoyen souffrent d’une mal gouvernance endémique. Chacun perçoit plus ou moins clairement les défis que représente la lenteur des réformes à produire leurs effets. Au-delà des divergences sur les solutions, il apparaît bien que notre pays se doit de moderniser sans plus tarder ses méthodes de concertation et de dialogue social qui lui permettront de répondre aux enjeux des temps nouveaux.
Aujourd’hui, en l’absence de règles et de normes de concertation, un dialogue de sourds s’installe entre les acteurs politiques et sociaux : le Gouvernement, le Parlement, le patronat, les syndicats, la presse, les associations, l’opinion… Dans chacun de ces grands ensembles, des représentations se construisent plus ou moins distantes les unes des autres sur les objectifs, les moyens, les priorités… La multiplication à profusion des instances de concertation est davantage le reflet d’une faiblesse, voire d’une impasse, que la manifestation d’une véritable densité des relations.
1. Des constats communs
Tous les acteurs du champs social s’entendent sur un certain nombre de constats communs. Les relations entre le Gouvernement et les partenaires sociaux connaissent régulièrement des périodes de tension et d’incompréhension réciproque. De façon récurrente, chacun accuse son interlocuteur de ne pas respecter les règles du jeu : les syndicats reprochent au Gouvernement de ne pas faire respecter le droit ; les syndicats et/ou le patronat suspectent les autres parties de collusion avec le Gouvernement (et réciproquement) ; les syndicats reprochent (discrètement) à la presse d’être manipulée ou de pousser à la surenchère ; les médias sont parfois amenés à quitter leur posture d’analyse pour devenir acteurs mêmes du dialogue. Le Gouvernement accuse les partenaires sociaux de ne pas être à la hauteur des enjeux…
Dans ces périodes de tension, les relations s’effritent : chacun repose la question de la légitimité de l’autre. Certains estiment que les organisations syndicales ne sont plus en état de négocier, c'est-à-dire, d’être en capacité d’aller jusqu’à la contractualisation et qu’il convient donc de s’en tenir avec eux à de simples concertations ; d’autres ne considèrent plus l’État comme un partenaire susceptible de respecter ses engagements...
Dans cet univers flou, l’évolution sociale pourrait laisser à penser que la conflictualité est en baisse. Il n’en est rien. La plus faible occurrence des grèves est pour partie compensée par la croissance du nombre d’actions revendicatives. La conflictualité est devenue éruptive, elle se traduit de plus en plus dans les manifestations spontanées. Ainsi au Maroc, les syndicats, porteurs d’intérêt collectif, se trouvent désormais concurrencés par de nouvelles formes de représentation. L’image publique des différentes composantes de la société civile est contrastée et oppose schématiquement le secteur des partenaires sociaux, considéré hâtivement comme sclérosé et en déclin, et le secteur associatif, dont l’expansion est régulièrement soulignée. Il y a là un nouveau trait de notre système de régulation sociale, dans lequel le dialogue dans la sphère du travail court régulièrement le risque d’être contrebalancé par les défauts structurels du dialogue dans d’autres sphères de la vie sociale.
Les corps intermédiaires prennent ainsi de multiples visages, quitte à permettre l’émergence d’acteurs incertains, mais en apparence plus cohérents car souvent porteurs d’un unique combat, ce qui facilite leur portée médiatique. En fait, la représentation de la société s’est diversifiée. Dans le même temps, les modalités d’intégration des individus à la société se sont complexifiées, voyant l’émergence d’identités moins durables et moins construites que les identités nationales ou syndicales, parfois fondées sur un projet commun (associations solidaires…), d’autres fois fondées sur une altérité commune (associations de victimes, de malades…) ou sur une situation partagée (associations de chômeurs, d’étudiants…).
2. De la défiance à des modes d’action innovants
Les motivations des contestations sont liées, sans l’être exclusivement, à la dégradation du pouvoir d’achat et des conditions de vie (éducation, accès aux soins, eau, électricité, transports...). On y retrouve des manifestations en faveur des projets sociaux de développement local…Ces manifestations, sit-in et marches pacifiques, touchent des zones reculées, oubliées. La sauvegarde de l’environnement trouve aussi sa place dans ce mouvement pluriel : lutte contre la pollution des nappes phréatiques ou en faveur de l’assainissement des villes et des quartiers. La dénonciation des formes de l’économie de rente n’est pas en reste : concessions de carrières de sables ou de mines. La dénonciation de la violence de l’État fait aussi partie des revendications de ces mouvements : il en est ainsi, de la dénonciation de l’usage scandaleux de l’argent pour l’achat des candidats et des grands électeurs lors des élections.
Les nouveaux mouvements sociaux reflètent les mutations fondamentales qu’a connues le Maroc (mouvement des femmes, mouvement des droits humains, droits culturels, droits économiques et sociaux..). Ces mouvements civiques se présentent comme les héritiers des mouvements syndicaux dont ils partagent les grandes valeurs fondatrices : droits humains, solidarité, justice sociale ... Mais ils diffèrent des précédents dans leur démarche, qui conduit à une vision entièrement nouvelle des façons de « faire de la revendication politique » et des exigences éthiques qu’elle implique.
Ces mouvements se démarquent des actions politiques traditionnelles par des formes d'action spécifiques : pétitions, doléances, recours à la justice, usage (pluriel) d'Internet, modalités spécifiques d’expression (la chanson) etc. Ils ne s’organisent pas suivant une forme hiérarchique traditionnelle (parti ou syndicat) mais dans un emboîtage de réseaux; ils ne se donnent pas un programme politique complet, mais tentent de présenter des propositions alternatives ; ils ne résolvent pas leurs contradictions inévitables mais ne se laissent pas enfermer dans de vieux clivages idéologiques: ils s’efforcent de fonder leurs actions sur la conquête et l’exercice des droits dans un souci d’indépendance et d’autonomie par rapport aux États et aux structures partisanes.
En effet, les mobilisations collectives interviennent dans un contexte de désenchantement politique, Ces mouvements débordent l’univers syndical ou/et partisan au sens étroit lorsqu’ils ne les réfutent pas purement et simplement. Dans la société d’aujourd’hui, l’essor des mobilisations segmentées, collectives ou spontanées, relève de tendances qui concernent la présence du «politique» dans la cité. Elles concernent aussi et surtout le statut de la démocratie aujourd’hui qui, dans le discours de nombreux mouvements sociaux, ne saurait se cantonner à la seule démocratie représentative, ni aux seules interventions du pouvoir politique. L’accroissement de la participation du citoyen à la prise de décision publique est également devenu d’autant plus nécessaire que l’intervention publique s’est démultipliée, manifestant les limites des procédures de décision uniquement fondées sur la représentation élective. D’où la nécessité de prendre en compte la proximité pour répondre aux revendications des populations confrontées à des besoins d’urgence.
Dans le paysage politique national, où se lit beaucoup de défiance, de retrait, de protestation, on devine l’émergence d’un nouveau type de citoyen de plus en plus critique. Mais on a l’impression qu’en même temps que les valeurs de la démocratie progressent à la surface de la société, la confiance dans l’État et dans les institutions de la démocratie représentative décline. En même temps, cette aliénation relative par rapport au régime démocratique favorise le développement d’une « politique protestataire » (mouvements extrémistes, activisme protestataire, agitations urbaines) et contribue à éroder le rapport à la loi commune et le sens de l’intérêt général. Cette défiance peut contribuer à déstabiliser le processus d’évolution démocratique qui ne bénéficierait plus que d’un soutien sceptique dans l’opinion, mais il peut aussi remettre la démocratie en mouvement en incitant à réfléchir à des réformes ayant pour but de dynamiser la démocratie représentative et de développer la démocratie participative.
3. Des attentes sociales plurielles
Les mouvements sociaux d’aujourd’hui agissent dans des contextes qui connaissent des évolutions très fortes sur le plan des régulations. Qu’ils s’inscrivent dans la tradition « classique » de la centralité des conflits du travail ou bien de la thématique des « nouveaux mouvements sociaux », les contextes institutionnels ou politiques auxquels ils renvoient se fondent sur la primauté des régulations politiques. Le « face à face » plus ou moins direct qui caractérisait dans le passé les rapports entre l’État et les mouvements sociaux a beaucoup perdu de sa pertinence et de sa réalité. Désormais, ces derniers s’inscrivent dans des contextes – des contextes de régulations- où interviennent des attentes multiples par des acteurs toujours plus nombreux et distincts, chacun de ceux-ci visant, selon ses propres intérêts, à influer sur les règles existantes, à les réformer où à en produire de nouvelles. Ces attentes expriment des mutations profondes de la société.
Une société dont les aspirations démocratiques évoluent : les formes traditionnelles d’engagement (militantisme politique et syndical) cèdent la place néanmoins à de nouveaux types d’action : le « potentiel protestataire.» augmente, tandis que l’on se mobilise sur des objectifs plus concrets et plus diversifiés, dépassant la stricte sphère du travail.
Une société où l’autonomie se développe : dans une société perçue comme un monde dur, compétitif, conflictuel, que l’individu ne maîtrise pas et par rapport auquel il se sent impuissant, on assiste, à la fois, à un attachement persistant à la liberté des choix individuels et à un renforcement de la demande de normes collectives et d’ordre public.
Le développement de nouvelles formes d’expression et d’action collective : qu’il s’agisse des activités économiques, sociales ou culturelles, il se développe, à côté des institutions publiques, des initiatives, individuelles comme collectives, qui révèlent la volonté de faire bouger les choses. Un problème précis touchant à la vie quotidienne est en général le moteur qui les déclenche, la revendication visant, dans certains cas, à transformer le fonctionnement de la société. Ces revendications reçoivent un écho dans les médias et dans la population. Dans leur ensemble, en tout cas, ces mouvements expriment moins un projet central, soutenu par un acteur central, que des constellations d’initiatives visant à transformer en profondeur tel ou tel aspect de la vie en société.
L’évolution du rôle des médias : la multiplication des canaux médiatiques, de même que l’interactivité autorisée par les technologies numériques, sont à l’origine d’une importante amplification des formes d’expression des revendications sociales.
Des attentes à l’égard de l’État : le recours à l’État central reste permanent dans notre pays. Il s’agit là d’un trait de notre culture nationale: certains penseront qu’il nous handicape, dans l’effort d’adaptation nécessaire; d’autres, au contraire, y verront un atout important pour la définition des régulations nécessaires. L’État est interpellé comme le garant ultime contre les risques : risques d’atteinte aux droits ; risques de précarité et d’exclusion ; risques de long terme, liés aux arbitrages intergénérationnels et aux questions d’environnement et de développement durable.
Il est également attendu comme le promoteur des libertés et des droits (formels et réels). La première exigence dans ce domaine est relative à l’emploi. Mais elle s’exprime aussi sous la forme d’une demande de droit à l’éducation, au logement, à la santé, à l’intégration... Enfin, pour les citoyens, l’État se doit d’être l’organisateur des procédures démocratiques : avec le développement de l’éducation et des médias, la demande de transparence de l’information, d’écoute et de concertation ainsi que l’exigence de débats avant la décision associant les parties concernées, de lisibilité dans les responsabilités, se font plus pressantes.
Le rapport de l’État à la société et du citoyen à l’État: des paradigmes à revoir
La réaction de l’État aux mouvements de protestation de ces derniers jours souffle un air de scepticisme sur ses capacités d’écoute des revendications portées par les jeunes et moins jeunes. On savait que la société était en ébullition, que l’État était sous la pression de demandes multiformes fusant sur tous les fronts. Des contestataires pour qui la revendication citoyenne n’est que la voie pour réclamer une part dans le partage du « gâteau ». D’autres qui clament à juste titre la fin du règne de la corruption, des passe-droits, de la prédation et de la rente. Sur ces mouvements incontrôlés, se greffent des revendications plus classiques ; celles des citoyens réclamant plus de justice sociale. Le mouvement de la contestation prend de l’ampleur, s’étend aux petites villes. Le monde rural n’est pas en reste avec des marches vilipendant la concussion de notables locaux ou revendiquant l’accessibilité aux services essentiels.
Dans ce mouvement, qui n’en finit plus de s’étendre et de grossir à l’image d’une « bulle sociale » menaçant d’éclatement, s’expriment des revendications politiques et sociales d’une incontestable légitimité, d’autres se perdent dans les méandres de la surenchère maximaliste. Des revendications portées par l’affirmation renouvelée des droits fondamentaux de la personne et une demande plus large de protection contre les risques dans la société. Les lieux de la contestation se déplacent et s’enchevêtrent, de nouveaux supports de débat apparaissent. Le développement des mouvements protestataires conduit à un face à face, non réglé, entre l’État, le citoyen et des groupes sociaux à géométrie variable et perpétuellement recomposés, qui ajoute à la difficulté de dégager la conception de l’intérêt général que devrait se forger la société.
Dans ce décor perturbé, brouillé se profilent : une société déboussolée, qui s’emballe dans les espaces de liberté ; un mouvement de jeunes, hétéroclite, se laissant déborder par des extrêmes où le nihilisme fraternise, sans état d’âme, avec l’islam radical ; des partis qui ont du mal à prendre en charge la demande de démocratie ; un État soufflant du chaud et du froid. Le tout donne cette impression d’un pays en risque de dérive, sur un fonds de divorce entre le Pays « réel » et le Pays « institutionnel ».
Pourtant, nous sommes dans un contexte bien spécifique. Une phase de réformes économiques et sociales substantielleset de réalisations de chantiers structurants, transformateurs des conditions et espaces de vie des citoyens. Une phase délicate qui devrait, tout en laissant libre cours à l’expression des droits, voir se manifester un sens plus aigu des responsabilités des uns et des autres. L’idéal serait que l’État, les organisations politiques et de la société civile parviennent à dialoguer de façon constructive et réaliste sur les orientations générales qui fondent l’avenir de la démocratie au Maroc. Ceci suppoe l’établissement de diagnostics partagés et une formulation de solutions alternatives, tenant davantage compte des réalités et des possibilités qui s’offrent au pays. Or, alors même qu’il entend permettre un apaisement, le processus de réformes ravive les revendications suscitées par le doute sur l’effectivité et l’efficacité des réformes sociales.
Dans ce processus de conduite des réformes et de gestion des chantiers structurants, le dialogue de sourds entre l’État et la société laissait entrevoir l’effusion d’une tension jusque-là contenue. Une certaine obsession centralisatrice où la quête de l’unanimisme sous-tendait, le plus souvent, le comportement de l’État. Celui de vouloir effacer la diversité des points de vue, canaliser les revendications, rechercher le consensus à tout prix. Une procédure classique et molle du fonctionnement du système politique. Les rapports conflictuels entre l’État et la Société ont fini par éclater au risque de compromettre le processus de réformes et la réalisation des chantiers en cours.
Dans cet enjeu crucial pour l’avenir du pays, l’État, plus que tout autre acteur, ne doit pas seulement agir pour consolider les démarches conformes aux critères de l’État de droit. Il lui faut aussi faire en sorte que la communauté sociale retrouve sa cohésion. Si dans la logique de l’État, la recherche de la « paix sociale » doit être érigée en finalité première de l’exercice du pouvoir, il est condamnable de la garantir par une répression expurgeant le corps social des turbulences qualifiées - souvent à tort- de « subversives ». L’État doit agir pour construire une « paix sociale » compatible avec le respect de droits de la personne et un fonctionnement pluraliste des institutions. La construction d’un État de droit impose la reconnaissance de l’autre comme « adversaire politique», au lieu de sa stigmatisation comme « ennemi de la Nation». C’est en s’interdisant tout recours massif et arbitraire à la répression que l’État pourrait donner une traduction politique au principe du pluralisme. Autrement, une violence policière serait le signe d’une restauration des pratiques répressives et de leur acceptation relative par les organes judiciaire, législatif et exécutif.
Par ailleurs, l’efficacité politique du mouvement de contestation est, aujourd’hui, étroitement liée non seulement à l’inscription de son action dans la société mais aussi dans les compromis politiques et sociaux qui la régissent à divers niveaux. Elle réside dans ses capacités à s’avérer crédible au sein des rapports qui le lient et l’opposent à divers acteurs publics. Il est fortement vraisemblable que la conviction de l’engagement citoyen caractérise beaucoup de mouvements sociaux et facilite leur mobilisation et leurs capacités revendicatives. Toutefois, une « obligation de responsabilité » devrait aussi s’imposer dans leur engagement, faute de quoi les actions concernées risquent d’être toujours plus fugaces et sans lendemain. L’efficacité politique de ces mouvements sociaux tient à leur capacité de transformer leurs revendications en règles contractuelles et de leur donner suffisamment de légitimité et de crédit pour qu’elles s’imposent dans la durée. Ce qui signifie les inscrire dans des processus continus et non éphémères ; les doter de capacités et d’un référentiel stable. Bref, seule l’efficacité politique transforme les mouvements sociaux en instance d’autorité, une autorité qui déborde le seul domaine des convictions ou de la morale pour s’étendre au « faire politique » et à la gestion, naturellement conflictuelle, des régulations sociales.
Certes, dans le paysage politique actuel se manifeste un nouveau type de citoyen de plus en plus critique; mais en même temps que les valeurs de la démocratie progressent à la surface de la société, la confiance dans l’État et dans les perspectives de la démocratie décline. Cette défiance vis-à-vis de l’État contribue à éroder le rapport à la loi commune et le sens de l’intérêt général. Le risque est que s’installe ainsi un hiatus entre une perspective démocratique en construction et une réalité marquée par le désenchantement. Ce décalage peut contribuer à déstabiliser le processus de réformes qui ne bénéficierait plus que d’un soutien sceptique dans l’opinion, alors que le défi est de remettre la démocratie en mouvement en incitant à réfléchir à des réformes ayant pour but de dynamiser la démocratie représentative et de développer la démocratie participative.