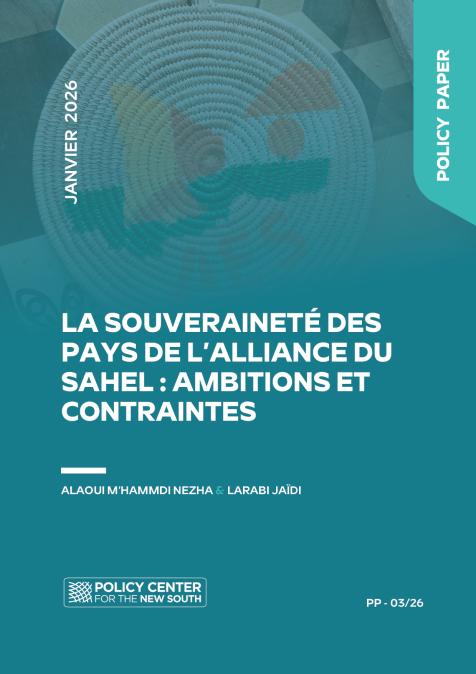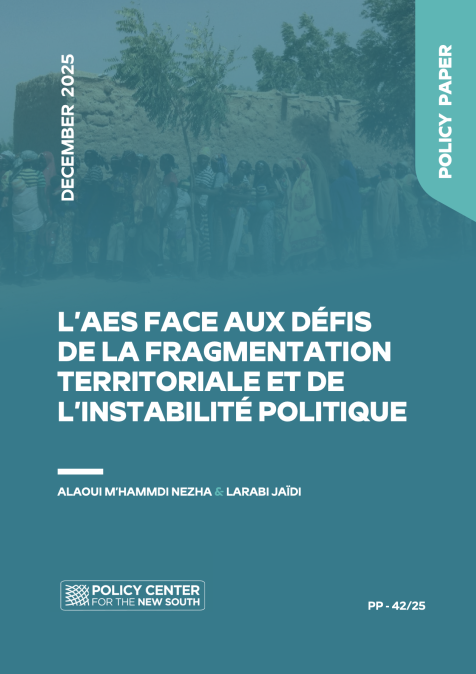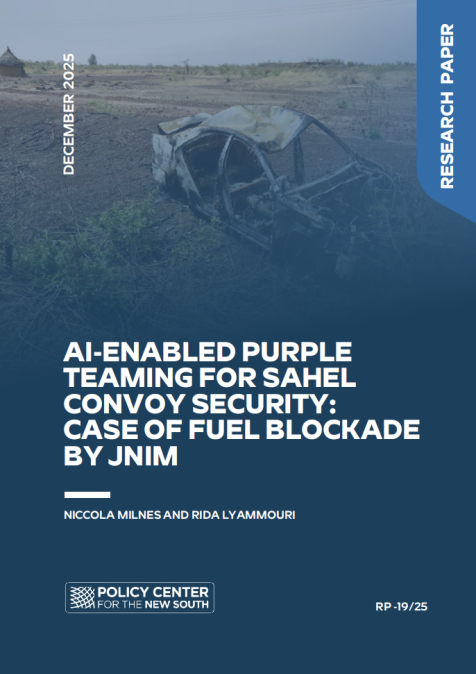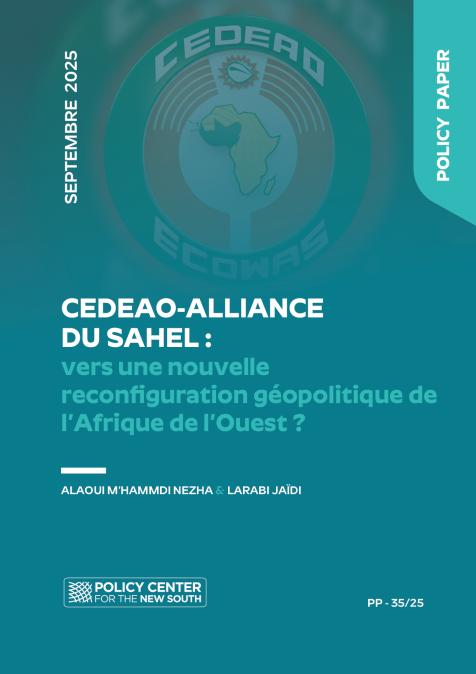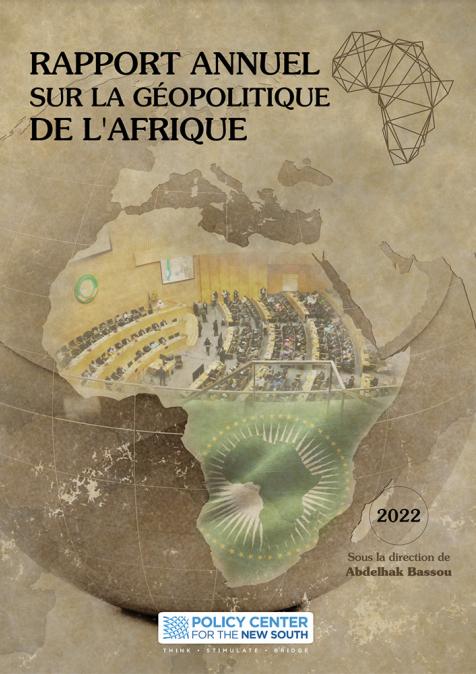Publications /
Opinion
Les panels programmés durant la deuxième journée de la conférence APSACO (le 19 juin) ont été consacrés aux principales priorités à traiter pour assurer la réussite des Opérations de Maintien de la Paix (OMP), notamment la protection des populations civiles et le renforcement des capacités des soldats de la paix.
La protection des civils : approche modulaire pour une meilleure adaptation aux menaces
Les intervenants ont été unanimes sur ce sujet : il doit être prioritaire dans les Opérations de Maintien de la Paix déployées sous la bannière de l’ONU. Ce principe est même aujourd’hui véritablement institutionnalisé au sein de l’ONU, devenant un paradigme désormais pris en compte et une valeur essentielle. C’est ce qui permis un progrès notable, notamment par rapport aux années 90 : aujourd’hui, deux tiers des OMP déployées à travers le monde comprennent un mandat de protection des civils.
Une réserve cependant : la mise en œuvre des mécanismes correspondants avait, au départ, tendance à être technique, presque mécanique et bureaucratique. Dans cette mise en œuvre du concept, on s’est davantage intéressé aux produits et aux activités de cette protection, plutôt qu’aux impacts et aux résultats. Il y avait donc un contraste entre l’action consistant à protéger et l’état des populations protégées. Une des intervenantes à la conférence a ainsi cité le cas d’une mission où de nombreuses et diverses actions avaient été engagées pour la protection des populations civiles sans toutefois connaître de résultats concrets et probants. Cette situation, qu’elle a qualifiée de décrochage, s’explique par une déconnexion entre la protection des civils, d’une part, et les stratégies politiques, d’autre part. Il arrive, parfois, argumente-t-elle, que les actions de protection des populations civiles soient en contradiction avec les stratégies politiques, du fait qu’elles sont perçues comme étant une tâche séparée des processus politiques, du plan de paix et des stratégies de sortie. Il est des situations où on se décharge sur le mandat de protection des civils qui se trouve, dans certains cas, dispensé d’une réflexion politique. En vue, justement, d’éviter ce travers, il faut donc lier les deux Agendas : la protection des civils doit être mise en œuvre suivant une approche modulaire pour les besoins de l’adaptation au contexte socio-politique du déploiement de l’OMP, partant du constat que la protection des civils ne peut pas être menée de la même manière en République Démocratique du Congo, en Centrafrique et au Mali. Cette protection doit être perçue comme étant une boîte à outils, ce qui permet de recourir, et selon les situations, à la simple présence sur le terrain, à la force armée, au dialogue, au renforcement de l’Etat ou, encore, à la liaison communautaire. Cette approche modulaire permet, aussi, de s’adapter aux différentes menaces.
Protection et renforcement des capacités des soldats de la paix
Il a également été rappelé lors de ces panels que les Casques bleus oeuvrent pour la construction et le maintien de la paix dans les contrées où elle est mise à mal, non sans ‘’s’exposer à des risques majeurs’’. Les contingents déployés dans le cadre des missions de la paix de l’ONU, notammet, opèrent dans des environnements chargés de risques. Ainsi depuis 2013, près de 200 soldats de la paix ont été la cible d’attaques meurtrières de groupes armés rebelles, dont 56 durant la seule année 2017.
Ces contingents sont formés dans un Centre dédié à la préparation des personnels désignés pour participer à des missions de maintien de la paix (policiers, militaires et paramilitaires), qui par les programmes et les stages dispensés, met en avant à la double cause de protection des soldats de la paix et de renforcement de leurs capacités. Mis en place par la CEDEAO et l’Union Africaine en 2011, ce Centre constitue désormais un passage obligé pour les candidats à la participation à des OMP à travers le continent, en vue de leur préparation à leurs missions. En un peu plus d’une décennie, cette Ecole aura formé plus de 12.000 soldats de la paix, aussi bien francophones qu’anglophones.
Dans un effort d’adaptation aux évolutions que connaissent les OMP, ce centre a intégré dans son cursus de formation la question de la protection et des civils et des soldats de la paix, un choix dicté par le degré de dangerosité atteint par des missions de maintien de la paix comme la MINUSMA, déployée au Mali, et qui est en passe de devenir la mission en activité la plus dangereuse côté civils (la MINUSCA, déployée en Centrafrique, mais également la MONUSCO, en République Démocratique du Congo, étant les plus dangereuses pour les soldats de la paix). Dans ces deux dernières missions de l’ONU, les militaires des contingents sont la cible des attaques perpétrées par des groupes armés rebelles. Aujourd’hui, rien que pour la MINUSMA, le nombre de soldats de la paix morts suite à des attaques de groupes armés rebelles, tous modes opératoires confondus, a dépassé la centaine.
Quel rôle pour l’Union africaine ?
L’Union Africaine, depuis sa création en 2002, affirme sa volonté d’assumer davantage sa responsabilité dans la prévention et la résolution des conflits dans le cadre des Opérations de maintien de la paix. Mais les réponses contrastées apportées par la même UA à des conflits survenus dans le continent ont parfois suscité des doutes quant à la capacité de l’organisation continentale à répondre à des situations de crise sans un soutien de l’extérieur.
Néanmoins, il faut prendre en compte des ‘’évolutions récentes’’, comme l’opérationnalisation de l’Architecture Africaine de Paix et de Sécurité (APSA), même si un regard sur les contraintes auxquelles fait face cette structure, en raison de son jeune âge et des mutations du contexte sécuritaire, appellent à des ajustements inévitables. A commencer par le fait que les impacts des conflits qui surgissent en Afrique ne concernent pas que le continent et constituent, de ce fait, des enjeux globaux. De plus, l’enjeu de l’appropriation africaine des crises porte davantage sur la coordination des moyens et des acteurs, tant aux niveaux local, régional que global.
En plus des désaccords soulignés entre les Etats membres de l’Union Africaine au sujet de l’opérationnalisation de l’APSA dans les crises malienne et centrafricaine, et des difficultés structurelles qu’elle accuse, les participants ont relevé un autre défi majeur de la structure au niveau du continent. L’Afrique en effet se compose de plus d’une cinquantaine de pays et s’étale sur une superficie de 30 millions de kilomètres carrés, soit l’équivalent des Etats-Unis d’Amérique, de la Chine, de l’Inde et d’une grande partie de l’Europe. A ceci s’ajoute la concurrence qui existe entre l’organisation continentale et les structures régionales. Le manque de clarté dans les mécanismes de coopération entre ces dernières génère des frictions au niveau de la répartition des rôles. La gestion de la crise malienne en 2012, en est une illustration.
Parmi les autres écueils relevés, il y a aussi l’asymétrie qui caractérise l’intégration sous-régionale : l’APSA repose ainsi sur un modèle pyramidal, basé sur une montée en puissance en partant des communautés régionales vers le sommet. Or, il existe des disparités dans l’évolution des structures régionales dans la mesure où la CEDEAO est le système régional le mieux abouti.
Toutefois, à l’actif de l’Union Africaine, il faut rappeler qu’elle constitue la principale organisation régionale à s’être dotée d’un mécanisme de prévention et de résolution de conflits complet calqué sur celui de l’ONU. De même que l’Acte constitutif de l’UA représente une évolution institutionnelle majeure, comparativement à ce qui était en vigueur sous l’ère de la défunte OUA, parce qu’il marque le passage à la posture de la non-indifférence, même proactive, en lieu et place de celle de la non-ingérence.
A l’épreuve des crises récentes, le dispositif de l’APSA, en raison de la culture militaire qui la sous- tend, s’est révélée inadaptée dans la mesure où son schéma est celui des opérations classiques de maintien et de consolidation de la paix dans lesquelles les parties belligérantes sont clairement identifiées. Ce schéma est désormais dépassé, vu le caractère asymétrique des menaces présentes. La conception pyramidale de l’APSA n’est par ailleurs plus adaptée, eu égard au fait que beaucoup de crises sont transfrontalières et transrégionales.