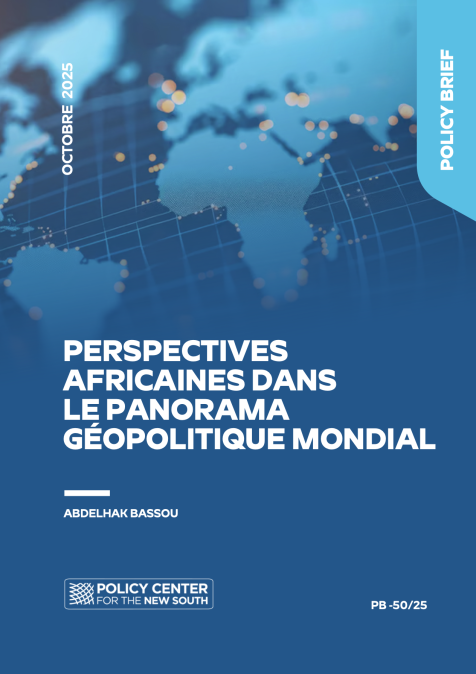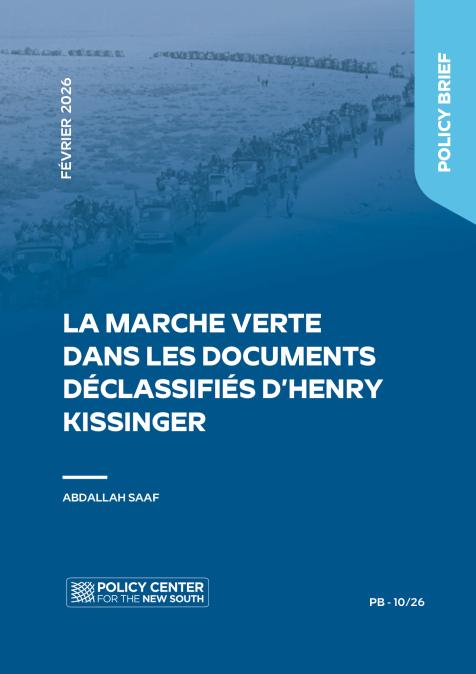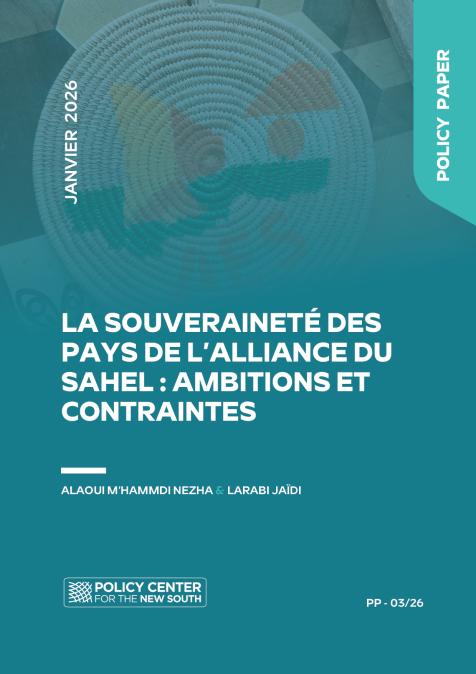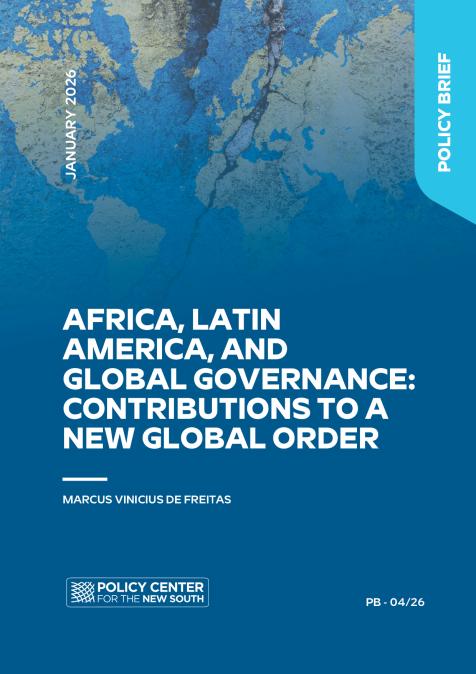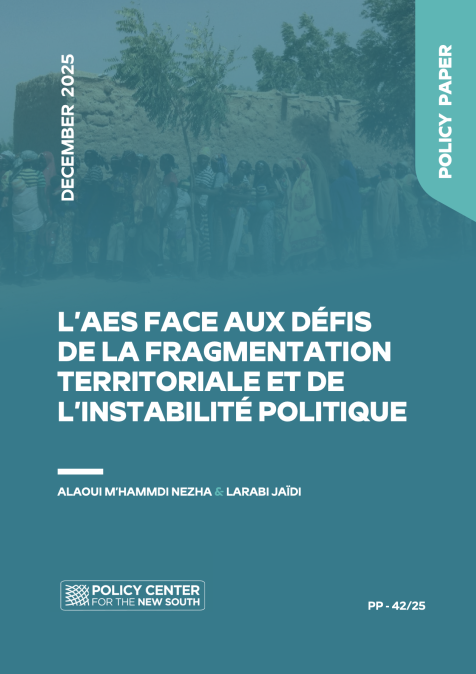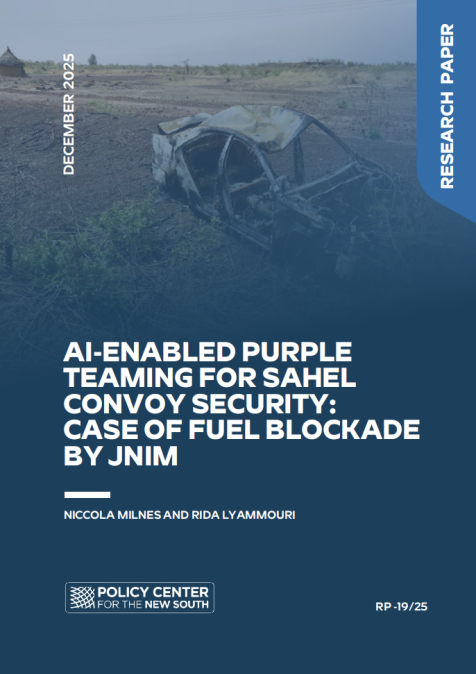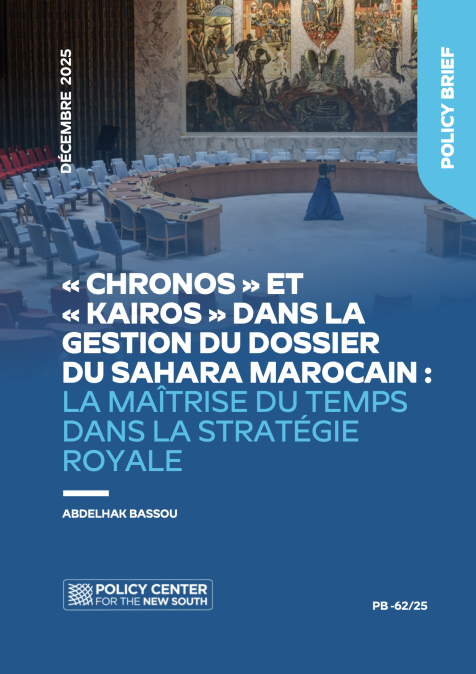Publications /
Policy Brief
Le panorama géopolitique mondial expose, certes, cruellement les vulnérabilités structurelles de l'Afrique (dépendance alimentaire, financière, exposition aux chocs), mais il ouvre aussi une fenêtre d'opportunités sans précédent depuis les indépendances. Le continent n'est plus seulement un objet de la géopolitique mondiale ; il tend de plus en plus à jouer un rôle d’acteur qui dispose d'une marge de manœuvre accrue. Le défi pour le continent et ses États et organisations est aujourd’hui d'éviter le piège de la simple substitution des dépendances. L’objectif du réveil africain n’est pas de passer de l'Occident aux BRICS+, de l’Europe à la Russie ou des États-Unis d’Amérique à la Chine ou de l'instrumentalisation dans une nouvelle guerre froide ; La priorité africaine doit être de transformer la concurrence entre les autres autour des richesses africaines en levier pour une véritable transformation structurelle de l’Afrique. Cette dernière (organisations et États) doit négocier des transferts de technologie, valoriser localement les matières premières, diversifier les économies, et renforcer l'intégration régionale (ZLECAf).
Introduction
Dans un monde interconnecté et interdépendant, où les frontières et les distances s’effacent devant les effets de la mondialisation, étudier les perspectives dans une partie ou région du monde suppose, à priori, de situer celle-ci dans le contexte global. Toute reconfiguration à l’échelle planétaire a un effet d’entraînement sur les quatre points cardinaux de la planète.
L’Afrique qui est, certes, entourée d’eau (deux mers et deux océans), n’est pourtant pas un îlot isolé. Le continent ne fait pas exception à la règle. Il évolue dans un système international dont les dynamiques façonnent en profondeur son développement, tracent les contours de sa sécurité et dessinent ses marges d’autonomie. L’Afrique n’a jamais été à l’écart des grandes recompositions géopolitiques mondiales.
L’histoire du continent est jalonnée d’épisodes où les grandes recompositions mondiales ont eu un impact direct sur ses trajectoires :
L’Afrique a été colonisée dans le sillage des empires européens du XIXᵉ siècle ; cette colonisation ne fut rien d’autre que le produit direct de la compétition impériale entre puissances européennes ;
elle s’est décolonisée dans un élan impulsé par la guerre froide ; c’est également cette dernière qui a divisé les États africains en blocs alignés et non-alignés ;
elle s’est vu imposer les ajustements structurels du fait de la globalisation néolibérale dans les années 1980 ; cette mondialisation a inséré les États africains dans les chaînes de valeur globalisées ;
après la chute du mur de Berlin, l’Afrique s’est trouvée au cœur de la rivalité entre les grandes puissances et les puissances émergentes ;
la vague du terrorisme et la lutte contre ce fléau qui ont marqué le nouveau siècle n’ont pas manqué de mettre le continent face à la prolifération d’un extrémisme violent qui continue de secouer nombre de pays et de régions africains ;
aujourd’hui encore, les chocs géopolitiques externes façonnent les marges de manœuvre africaines :
fluctuations des prix de l’énergie ;
ruptures logistiques ( détroit de Bab El Mendeb) ;
réorientation des flux financiers et diplomatiques.
Commentant la guerre en Ukraine et ses impacts sur l’Afrique, Moussa Faki Mahamat, ancien président de la Commission de l’Union africaine, souligne que « L’Afrique est devenue la victime collatérale d’un conflit lointain, celui entre la Russie et l’Ukraine. »
Il est donc clair que l’Afrique, hier comme aujourd’hui, se place dans le champ d’impact des inflexions géopolitiques mondiales qui définissent les marges de manœuvre des États africains, influencent leurs partenariats économiques et sécuritaires, et orientent leurs choix diplomatiques ; avec une question qui devient récurrente : l’Afrique se démarque-t-elle d’un statut d’objet de la géopolitique mondiale à celui d’acteur agissant ?
La question se pose du fait que la dépendance structurelle n’empêche pas l’émergence d’une volonté africaine d’agir pour ne plus se suffire d’une position de cible que visent les tirs de puissances plus ou moins grandes, mais aussi pour briguer une position d’acteur ayant lui aussi ses cibles, ses objectifs et ses desseins à réaliser. Se cantonner dans un rôle d’objet qui ne fait que subir, n’est plus une fatalité pour le continent ; l’Afrique trouve désormais dans le panorama géopolitique mondial des opportunités d’être maitresse de son destin. Cette prise de conscience par l’Afrique de ses capacités à agir commencent à se matérialiser sur la scène internationale par plus d’un fait. L’admission de l’Union africaine comme membre permanent du G20 en 2023, et l’ambition nourrie par le continent de disposer d’un siège de membre permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies dans le cadre d’une future réforme ; témoignent de l’éveil des Africains et de leur recherche du renouveau digne de leurs potentiels.
L’Afrique passe progressivement du statut d’objet à celui d’acteur des relations internationales. Mais sa capacité d’action reste conditionnée par l’état du système mondial ; c’est pourquoi comprendre ses perspectives impose d’abord d’examiner les dynamiques géopolitiques globales en cours. Ainsi, pour examiner les perspectives africaines à la lumière données géopolitiques mondiales, ce Papier sera scindé en deux parties :
la première, consacrée aux marqueurs géopolitiques de la situation mondiale actuelle ;
la seconde se penchera sur les impacts de cette situation mondiale sur le continent africain.
Les marqueurs géopolitiques de la situation mondiale actuelle
La Permapolycrise
Les temps actuels sont marqués par le recul de l'hégémonie occidentale et l'émergence, dans une douleur qui ne s’est pas encore estompée, d'un ordre contesté et instable qualifié de monde en « polycrise »[1] ; Ce concept de crise multiple s’ajoute à celui de « permacrise »[2] qui bouscule le sens classique de « crise ». Cette dernière était comprise comme étant une situation où la flambée de tensions monte jusqu’au pic, pour enregistrer, ensuite, une décrue. Aujourd’hui, cette définition classique laisse la place à un sens où la crise devient permanente au point de constituer une nouvelle normalité. Quand elle atteint le pic, la crise prend une vitesse de croisière sans connaitre de décrue notable. La longévité des conséquences des crises leur donne une allure de pérennité.
Le monde d’après la chute du mur de Berlin s’est forgé dans une série de crises géopolitiques et sécuritaires, dont principalement :
l’événement du 11 Septembre 2001 ;
crise financière de 2008 ;
le « Printemps arabe » ;
l’épidémie de la Covid -19 ;
l’invasion de l’Ukraine par la Russie et ;
la guerre entre Israël et le front de résistance iranien depuis le 7 octobre 2023.
Si les deux dernières crises sont toujours en cours, force est de constater que celles plus anciennes qui semblent s’être estompées, ne font en réalité que se prolonger du fait que leurs conséquences ont marqué de manière irréversible les données géopolitiques du monde. Les impacts de ces crises, qui s’inscrivent dans la durée et touchent de multiples aspects des politiques mondiales, se situent également dans le temps long, au point de devenir permanent. La crise mondiale est permanente et à têtes multiples ; une « Permapolycrise ».
Le monde vit une crise qui du fait de sa multiplicité et de sa longévité s’incarne dans une réalité géopolitique empreinte de bouleversements divers, dont les effets sont quasi-permanents. La nouvelle normalité, fruit de crises complexes et durables, génère un nouveau paysage des relations internationales.
Un paysage mondial dessiné par de nouveaux marqueurs géopolitiques
La fin de la ‘’Pax Americana’’ et le piège de Thucydide
Les États-Unis restent la première puissance militaire et financière, mais leur leadership est contesté. La crise financière de 2008, les retraits chaotiques d'Afghanistan et d'Irak, la montée en puissance de la Chine et son impuissance devant des conflits et guerres auxquels elle ne peut mettre un terme, ont durablement entamé la crédibilité du « gendarme du monde ». L'unipolarité des années 2000 a cédé la place à un monde où plusieurs pôles – Chine, Russie, Inde, Union européenne – défendent des visions qui s’opposent à l'ordre international, jusqu’à présent, établi et conduit par les États-Unis. Ces derniers se trouvent face à la Chine dans une rivalité structurelle qualifiée de « piège de Thucydide ». Cette rivalité est totale : elle est économique (guerre commerciale, contrôle des chaînes de valeur, course aux semi-conducteurs) ; elle est militaire (militarisation de la mer de Chine méridionale, alliances comme l'AUKUS) et, elle est aussi idéologique (démocratie libérale vs. capitalisme d'État autoritaire). Le risque d'un conflit ouvert, évoqué par le concept de « piège de Thucydide » de Graham Allison, plane sur la planète. Le conflit est jusqu’à présent évité, mais il reste à la merci d’une simple erreur d’appréciation. De plus, sans se matérialiser en guerre véritable, il diffuse des tensions qui génèrent un climat empreint d’angoisse géopolitique qui paralyse les relations internationales.
La résilience et l'expansion des blocs alternatifs : le cas des ‘’BRICS+’’
Le sommet de Johannesburg, en août 2023, a acté l'élargissement du groupe aux Émirats arabes unis, à l'Égypte, à l'Éthiopie, à l'Iran et à l'Arabie saoudite. Cet élargissement, stratégique et non idéologique, crée un club hétéroclite mais puissant qui représente plus de 45 % de la population mondiale et plus de 36 % du PIB mondial (en PPA). Son objectif affiché est de déconstruire l'hégémonie économique et financière occidentale, notamment américaine, en promouvant des institutions parallèles (Nouvelle Banque de Développement) et l'usage des monnaies locales.
Le retour de la guerre de haute intensité en Europe et l'instabilité chronique et évolutive au Moyen-Orient
L'invasion de l'Ukraine par la Russie, le 24 février 2022, a acté la rupture définitive avec l'ordre post-1991. Au-delà de l'horreur humaine, ce conflit a eu un effet détonateur sur l'économie globale, révélant la dépendance énergétique de l'Europe et la vulnérabilité des chaînes alimentaires mondiales, dont l'Afrique est la première victime collatérale.
Au-delà du conflit israélo-palestinien, la région est marquée par la normalisation rampante entre Israël et certains États arabes (Accords d'Abraham), la course nucléaire iranienne, et les guerres par proxy qui ensanglantent le Moyen-Orient. Ces conflits ont des répercussions directes sur la sécurité et la stabilité énergétique du monde.
L'évolution de la situation et une tendance à l’incertitude et à la complexité
La dynamique engendrée par les ‘’drivers’’ géopolitiques cités plus-haut laissent entrevoir un horizon marqué par :
la polarisation et la « Diplomatie du Camp » (Avec nous ou contre nous)
La tendance est à la fragmentation en sphères d'influence et à la résurgence de blocs économiques et sécuritaires. Les pays qui s’enregistrent dans le no-man’s land entre les puissances classiques et émergentes et que certains sont enclins à nommer « Sud Global », sont sommés de choisir leur camp, une position qu'ils rejettent au nom de la souveraineté nationale et du non-alignement ou du multi-alignement. Ces pays sont appelés à choisir et pour beaucoup d’entre eux refusent de le faire, ils souhaitent avoir de bons rapports avec tout le monde et ne veulent être le satellite d’aucune puissance ou groupe de puissance ;
Projection du panorama géopolitique mondial sur l'Afrique :
Deux facteurs seront principalement retenus pour illustrer l’impact sur l’Afrique, de la situation géopolitique mondiale ; les conflits majeurs, d’une part ; et la rivalité des puissances autour du continent, d’autre part.
Répercussions des conflits majeurs : le prix de l'interdépendance
Le Conflit en Ukraine : ce choc exogène crée en Afrique une crise aux facettes
Le Conflit au Moyen-Orient : proximité géographique et fractures idéologiques
multiples. De la sécurité alimentaire aux dilemmes politiques en passant par la crise énergétique et l’inflation, ce conflit prolonge les effets de la Covid -19.
L'Afrique importe plus de 85 % de son blé, dont plus de 40 % provenait de Russie et d'Ukraine avant la guerre. L'envolée des prix (jusqu'à +45% pour le blé en 2022, selon la FAO) a plongé des millions de personnes dans l'insécurité alimentaire. L'Égypte, premier importateur mondial de blé, a vu son budget exploser et sa stabilité sociale menacée. L'Initiative céréalière de la mer Noire, négociée par la Turquie et l'ONU, fut une bouée de sauvetage vitale, montrant la dépendance directe du continent à la résolution d'un conflit distant.
La flambée des prix du pétrole et du gaz a, certes, profité aux pays producteurs (Angola, Nigeria, Algérie) mais a étranglé les pays importateurs. Pire, la hausse des prix des engrais a menacé les récoltes locales de la saison suivante, créant un cycle infernal. Le FMI a estimé que ce choc a coûté plusieurs points de croissance au continent.
Sur les 54 États africains, seuls une quinzaine ont régulièrement voté pour condamner la Russie à l'ONU. Beaucoup se sont abstenus ou étaient absents. Ce vote n’est pas un soutien à la Russie, mais l’expression d’un paradoxe devant une situation en Ukraine, , certes condamnable, d’une part, et les relations historiques et actuelles de certains pays avec la Russie, d’autre part. Pour d’autres pays africains, le vote constituait une sorte de défiance envers l'OTAN, perçue comme belliciste et un refus de s'aligner sur un agenda qui n'est pas perçu comme prioritaire pour leurs populations.
Le ministre des Affaires étrangères du Kenya résume cette situation en déclarant : « on nous demande de choisir entre l'ours et le dragon, alors que nous devrions nous concentrer sur l'antilope qui broute dans notre jardin ».
L'instabilité au Moyen-Orient alimente directement l'insécurité au Sahel et en Afrique de l'Est. Les groupes jihadistes, comme AQMI, JNIM ou les Shebab somaliens, s'inspirent idéologiquement et reçoivent parfois des financements de réseaux transnationaux. L'escalade de violence au Gaza risque de servir de puissant outil argumentaire de radicalisation et de recrutement pour ces groupes.
Cette guerre à Gaza a exposé les profondes divisions internes au continent. L'Afrique du Sud a porté plainte contre Israël pour « génocide » devant la Cour Internationale de Justice (CIJ), réactivant son héritage de lutte anti-apartheid. À l'inverse, des pays, comme le Cameroun ou le Tchad, ont historiquement des liens plus discrets avec Israël. Le Maroc, qui a repris ses relations avec Israël en 2020, soutient la cause palestinienne tout en sauvegardant ses intérêts stratégiques. Ces divisions empêchent une position continentale unie, et affaiblissent la voix de l’Afrique.
De plus, la région de la Corne de l’Afrique mitoyenne du Moyen-Orient vit les effets directs de la guerre entre Israël et le front iranien. L’Égypte voit ses revenus du Canal de Suez perturbés par l’action des Houtis en mer Rouge, d’autres pays tels que la Somalie sont directement liés aux théâtres des opérations au détroit de Bab El Mendeb.
Interférences et jeu des puissances : l'Afrique, nouvel échiquier des grands jeux
L’examen des relations entre l’Afrique et les puissances émergentes et entre le continent et l’Occident montre deux situations qui évoluent selon des courbes opposées. Si les relations entre l’Afrique et les BRICS+, par exemple, sont sur une courbe ascendante, celle avec l’Europe est sur la pente du déclin. Le partenariat avec le premier est encore à l’épreuve des faits, et avec le second doit résister aux vicissitudes d’une histoire tourmentée.
Afrique / BRICS+.
Afrique / Occident : un partenariat en redéfinition
La Chine est devenue le premier partenaire commercial bilatéral de l'Afrique depuis 2009. Son modèle, basé sur la « non-ingérence » et le financement d'infrastructures visibles (stades, ports, railways), contraste avec les conditionnalités de l'Occident perçues comme paternalistes. Le discours des BRICS+ sur la démocratisation des relations internationales et la dédollarisation séduit des élites politiques cherchant à affirmer leur souveraineté. L'entrée de l'Égypte et de l'Éthiopie dans le groupe est perçue comme une victoire diplomatique et un accès potentiel à de nouveaux financements. Il reste cependant les BRICS+ qui sont attendus sur les faits. En effet, en dehors de la Chine, les autres membres du groupe doivent encore agir pour séduire l’Afrique.
Même avec la Chine, le revers de la médaille est lourd. Les prêts chinois, souvent opaques, ont contribué à alourdir la dette de nombreux pays (Angola, Zambie, Kenya). Le modèle « infrastructures contre matières premières » reproduit une spécialisation primaire et offre peu de transferts de technologie ou de création d'emplois durables. Parallèlement, la Russie, en dehors de ses interventions militaires via des groupes à statut contesté, fait peu pour aider au développement des pays africains.
L'Europe reste le premier partenaire commercial global de l'Afrique. Les États-Unis conservent une présence militaire cruciale et sont un bailleur de fonds majeur dans la santé. Face à l'offensive chinoise, l'Occident tente de se repositionner avec de nouvelles initiatives comme le ‘’Global Gateway’’ de l'UE (300 milliards d'euros) ou le ‘’Build Back Better World’’ (B3W) du G7, promettant des investissements « durables, transparents et guidés par les valeurs »
Ce partenariat traditionnel est, pourtant, en crise profonde. Le sentiment anti-français au Sahel, culminant avec les expulsions des troupes françaises du Mali, du Burkina Faso et du Niger, est symptomatique d'un rejet post-colonial d'une présence perçue comme paternaliste et inefficace.
Les Africains, contrairement à une apparence alimentée par les médias, ne veulent pas rompre avec l’Occident ; ils veulent revisiter la relation et avoir un partenariat nouveau où les anciennes perceptions négatives laissent la place à un respect mutuel et à la sauvegarde réelle des intérêts de tous.
Conclusion
En conclusion, force est de constater que le monde du XXIème siècle continue de se chercher dans le tourbillon des crises et des incertitudes ; Un monde dont les anciennes structures de fonctionnement tournent de l’œil, sans que de nouveaux mécanismes de gouvernance mondiales n’aient encore vu le jour.
Cette nébuleuse géopolitique mondiale se répercute sur l’Afrique en laissant paraitre deux angles d’abordage de la situation, par le continent :
un angle de vision optimiste qui veut que le bouillonnement du monde classique est une opportunité qui permet à l’Afrique de se faire une place dans la gouvernance internationale future et ;
une vision plutôt pessimiste disant que seuls les anciens puissants et quelques émergents nantis pourront mener les manœuvres de façonnement d’un monde futur.
Quelle vision adoptera l’Afrique ? ‘’That is the Question’’.
[1] Une notion brièvement évoquée par Edgar Morin et la journaliste Anne-Brigitte Kern dans le livre Terre-Patrie[1] (1993) et reprise récemment dans les articles de l’historien Adam Tooze et le politologue Thomas Homer-Dixon.
[2] mot de l’année 2022 pour le dictionnaire anglais Collins