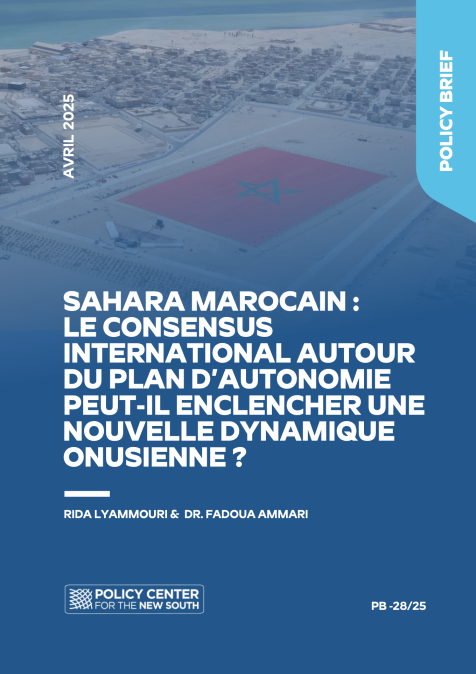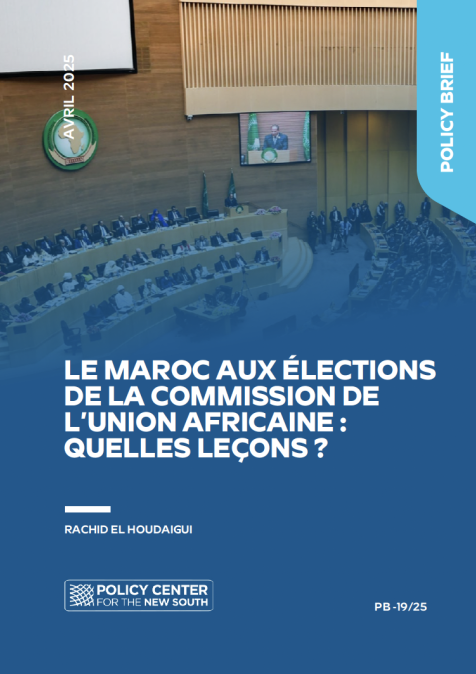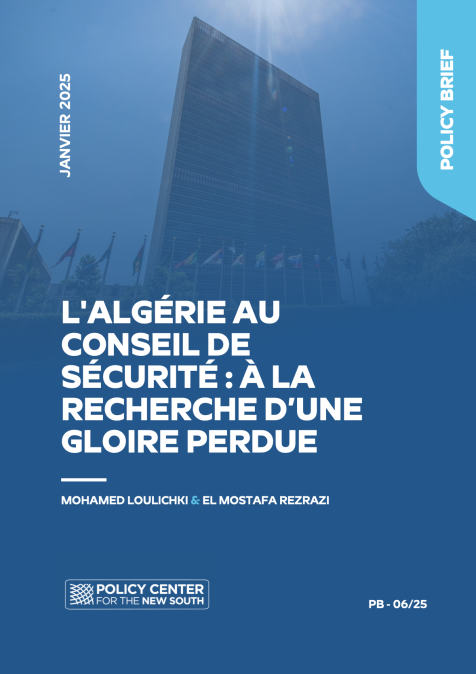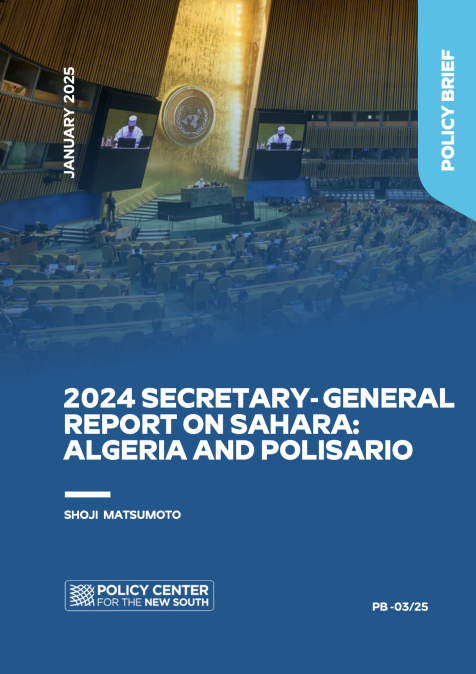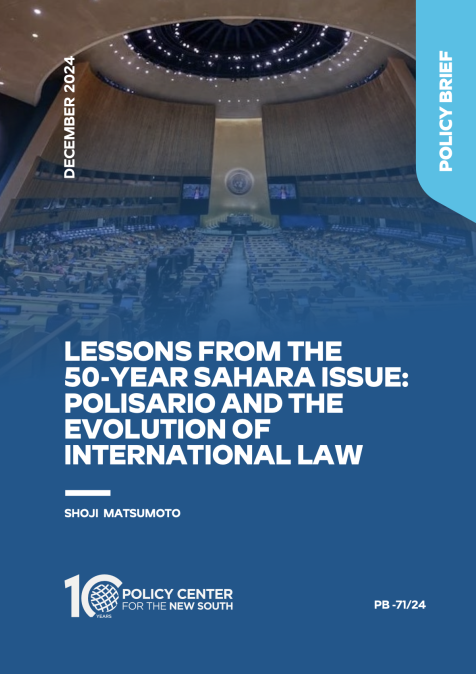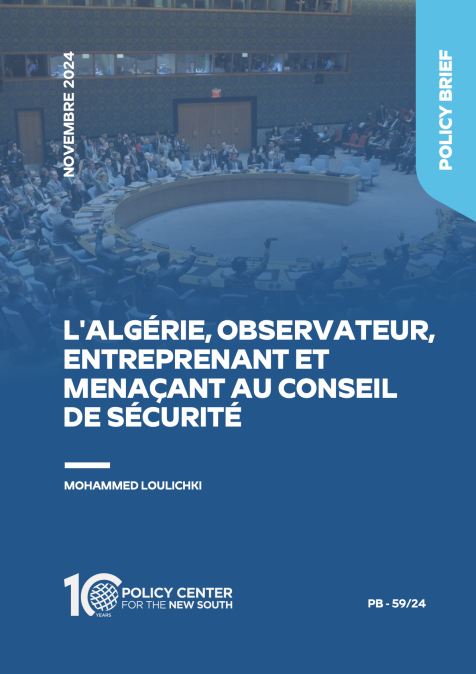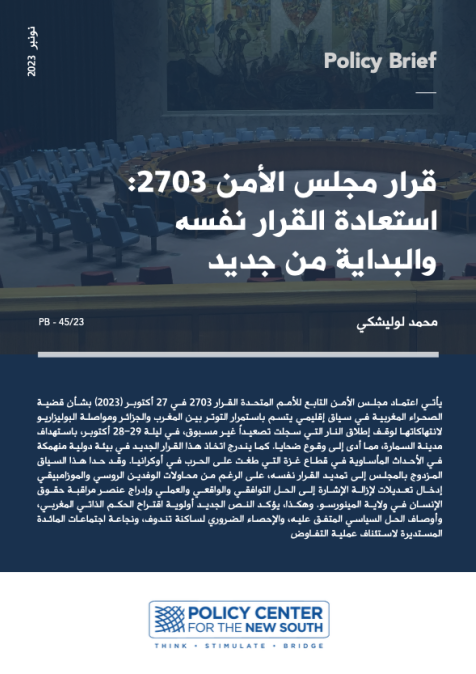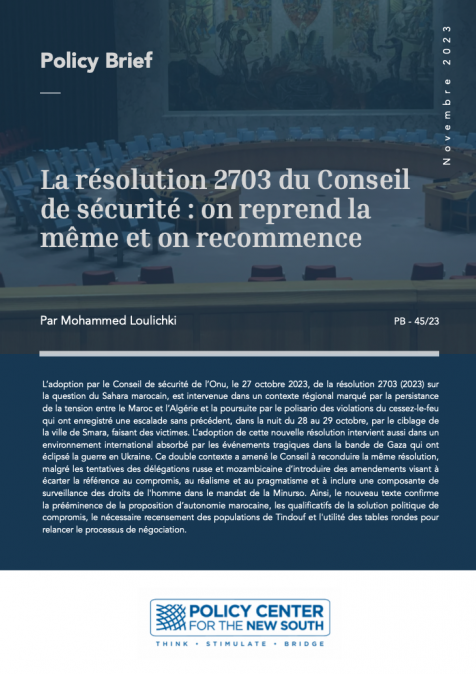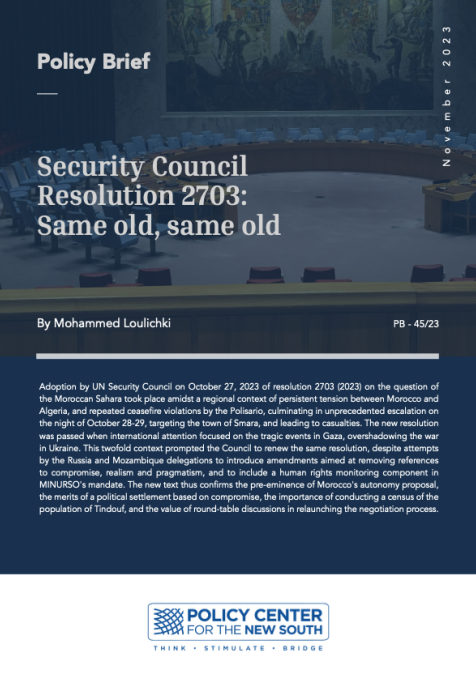Publications /
Policy Brief
Ce Policy Brief examine les perspectives d’évolution de la position des Nations Unies sur le dossier du Sahara marocain à la lumière des récentes dynamiques diplomatiques. Il s’appuie sur la réaffirmation du soutien américain au Plan d’autonomie proposé par le Maroc, qui a contribué à élargir un consensus international en faveur d’une solution pragmatique. Malgré des signes positifs au sein du Conseil de sécurité, le processus onusien demeure bloqué, notamment en raison de divisions persistantes entre les États membres et de l’inertie de la Mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental (MINURSO). Dans ce contexte, une nouvelle doctrine onusienne, recentrée sur le réalisme et le compromis, apparaît nécessaire. L’ONU est donc invitée à sortir de sa posture d’attentisme pour accompagner activement une solution politique fondée sur l’autonomie sous souveraineté marocaine. Il en va de sa capacité à demeurer un acteur central et pertinent dans la résolution des différends régionaux.
Introduction
La question du Sahara marocain demeure l’un des différends régionaux les plus persistants dans l’agenda des Nations Unies. Après cinq décennies d’impasse, la réaffirmation explicite, le 8 avril 2025, du soutien des États‑Unis au Plan d’autonomie proposé par le Maroc semble rebattre les cartes diplomatiques. Dans ce contexte, une interrogation centrale s’impose : cet engagement renouvelé de Washington, et la dynamique de convergences qu’il suscite auprès d’un nombre croissant d’États, peut‑il enclencher une véritable relance du processus onusien ? Autrement dit, l’appui américain, désormais relayé par un consensus international élargi, est‑il susceptible de faire évoluer la doctrine des Nations Unies et de débloquer la négociation politique encadrée par l’Organisation ?
Ce Policy Brief éclaire l’opportunité actuelle d’une inflexion onusienne. Il examine successivement : (I) les signaux positifs à l’ONU et les blocages persistants dans la situation actuelle, (II) l’« effet domino » engendré par l’appui américain conduisant potentiellement à un plan multilatéral, et, enfin (3), la nécessité d’agir plutôt que d’attendre, c’est-à-dire les contours possibles d’une nouvelle doctrine des Nations Unies sur le Sahara. L’objectif est de mettre en lumière l’opportunité d’une évolution de la position onusienne, tout en soulignant le rôle constructif du Maroc dans la recherche d’une solution réaliste, pacifique et durable à ce conflit.
Signaux positifs ou blocage persistant ? Lecture réaliste de la situation actuelle à l’ONU
Cinquante ans après le début du conflit autour du Sahara marocain, la scène onusienne présente aujourd’hui un contraste manifeste entre des signaux positifs d’évolution et un blocage persistant du processus politique de résolution. Du côté des avancées, le Conseil de sécurité de l’ONU a progressivement adopté une approche plus réaliste et favorable au Plan d’autonomie. Il insiste désormais sur la nécessité d’une « solution politique réaliste, pragmatique, durable et mutuellement acceptable » fondée sur le compromis.[1] Ce changement de ton traduit une reconnaissance implicite par l’ONU de la viabilité du Plan d’autonomie comme base de règlement. De même, des États membres du Conseil, d’Afrique et du Golfe, ont publiquement affirmé à l’ONU leur soutien à la souveraineté marocaine sur le Sahara et à l’initiative d’autonomie, jugée « solide, sérieuse et conforme à la Charte des Nations Unies ».[2] Ces prises de position, invraisemblables il y a encore quelques années, constituent des signaux diplomatiques positifs indiquant un frémissement du consensus onusien en faveur de la proposition marocaine.
Cependant, malgré cette évolution du discours, la réalité opérationnelle à l’ONU reste marquée par l’impasse. En pratique, le processus politique piloté par les Nations Unies n’a pas encore enregistré de percée décisive vers un règlement. Plusieurs facteurs explicatifs mettent en lumière un blocage persistant. D’abord, sur le terrain, la violation du cessez-le-feu conclu en 1991 en novembre 2020, à la suite des incidents de Guerguerat, illustre la fragilité du statu quo et l’urgence d’une solution, tout en compliquant la tâche onusienne. Ensuite, la MINURSO elle-même est en panne d’efficacité : créée en 1991 pour organiser un référendum d’autodétermination, elle « n’a jamais rempli son mandat et n’a fait que maintenir un état de paralysie au fil des années» .[3] Dans ce constat d’impasse diplomatique, la MINURSO apparaît de plus en plus comme une mission « obsolète et dysfonctionnelle »[4], incapable de dépasser la logique du statu quo ou de contribuer de manière effective à une sortie politique du conflit. Or, la présence de la MINURSO confère une légitimité internationale au processus politique : elle symbolise l'engagement de la communauté internationale en faveur d'une solution pacifique.[5]
Par ailleurs, les dynamiques internes au sein du Conseil de sécurité constituent un obstacle structurel à l’émergence d’un consensus. Certes, une large majorité s’est prononcée (13 membres sur 15) en faveur des récentes résolutions prorogeant le mandat de la MINURSO[6], mais des divergences notables subsistent. Des membres importants continuent de s’abstenir systématiquement : la Russie (membre permanent) et, selon les périodes, deux États membres africains proches des thèses algériennes (en 2021-2022, Mozambique en 2023-2024, et l’Afrique du Sud). Ce climat témoigne d’une fracture persistante au sein de l’ONU entre, d’un côté, la majorité des États alignés sur une solution pragmatique sous égide marocaine et, de l’autre, une minorité d’acteurs demeurant attachés à l’ancienne logique référendaire ou s’abstenant systématiquement d’exercer une pression significative sur le polisario, contribuant ainsi à la perpétuation de l’impasse.
Enfin, un dernier indicateur du blocage actuel est l’enlisement du volet diplomatique incarné par l’Envoyé personnel du Secrétaire général pour le Sahara. Nommé en 2021, Staffan de Mistura n’est pas parvenu, à ce jour, à relancer des négociations directes entre les parties. Malgré plusieurs visites dans la région et consultations informelles, aucune table ronde n’a pu être réunie depuis 2019. La marge de manœuvre de l’émissaire onusien s’est même réduite à mesure que les positions se durcissaient en dehors de l’ONU : face à l’évolution rapide des équilibres internationaux depuis 2020, son rôle s’est trouvé marginalisé, à tel point que des sources diplomatiques ont évoqué sa possible démission fin 2024,[7] faute de progrès palpable.
Dans ce contexte, une lecture réaliste de la situation actuelle à l’ONU conduit à un constat nuancé : oui, les signaux positifs s’accumulent quant à la reconnaissance internationale de la solution marocaine au sein même du Conseil de sécurité ; mais en parallèle, le processus onusien demeure enlisé du fait de l’intransigeance de certains acteurs et d’un cadre de négociation qui n’a pas encore été réactualisé pour s’adapter à la nouvelle donne.
De l’appui américain à la structuration d’un consensus
Face à ce constat mitigé, l’on observe qu’en dehors de l’enceinte onusienne stricto sensu, une dynamique diplomatique internationale d’ampleur s’est enclenchée ces dernières années en faveur de la position marocaine, dynamique dont le catalyseur principal a indéniablement été le soutien américain renouvelé.[8] L’effet domino initié par Washington se manifeste par le ralliement successif de nombreux États influents, tels que la France et l’Espagne, à l’initiative d’autonomie, ouvrant la voie à l’élaboration possible d’un plan multilatéral de règlement sous l’égide de l’ONU.
Cependant, au-delà des ex-puissances coloniales européennes, c’est une coalition internationale élargie qui se dessine en faveur de la solution marocaine. Dans le monde arabe, les pays du Golfe (tels que les Émirats arabes unis, l’Arabie saoudite, le Qatar, le Koweït…) soutiennent ouvertement le Maroc – les Émirats ayant même été le premier pays à ouvrir un consulat au Sahara marocain dès 2020, suivis par une quinzaine d’États arabes et africains. En Afrique subsaharienne, plusieurs pays ont établi des consulats à Laâyoune ou à Dakhla, concrétisant leur reconnaissance de facto de la souveraineté marocaine sur la région. Parallèlement, de nombreux États africains et latino-américains ont retiré ou gelé leur reconnaissance de la « République arabe sahraouie démocratique » (RASD) autoproclamée par le polisario. Rien que depuis fin 2024, le Ghana, le Panama et l’Équateur ont successivement annoncé ne plus reconnaître la RASD.[9] Si bien qu’en ce début 2025, plus de « 85 % des États membres des Nations Unies ne reconnaissent pas l’entité séparatiste » du polisario.[10] Ce chiffre éloquent traduit l’érosion constante, presque irréversible, du soutien international au projet séparatiste du polisario.
Cette convergence internationale s’observe également au sein du système onusien lui-même, par exemple dans les travaux du Comité spécial de décolonisation (Comité des 24, C24) où de plus en plus de délégations africaines et caribéennes se félicitent des efforts marocains et plaident pour une solution de compromis plutôt que pour le référendum inapplicable.[11]
L’ampleur de cet effet domino diplomatique crée les conditions propices à la mise en place d’un plan multilatéral de règlement, orchestré par les Nations Unies. Concrètement, comment le soutien bilatéral de multiples États peut-il se traduire en dynamique onusienne collective ?
D’abord, au niveau du Conseil de sécurité, la consolidation d’un front pro-autonomie de grande envergure augmente la pression pour que les prochaines négociations sous l’égide onusienne se concentrent exclusivement sur le schéma de l’autonomie. Lorsque 60 % des pays du monde, dont plusieurs membres influents du Conseil, considèrent qu’il n’existe pas d’alternative viable à l’autonomie, il devient difficile pour l’ONU de maintenir l’idée que le Sahara marocain peut devenir un État indépendant comme option équivalente. On peut ainsi envisager que la prochaine résolution du Conseil de sécurité aille plus loin encore dans la définition des paramètres de la solution : il ne s’agirait plus seulement de prendre note de la proposition marocaine, mais de l’édifier clairement en référence centrale du processus politique. Les déclarations américaines récentes pointent d’ailleurs en ce sens, affirmant que le plan d’autonomie est « l’unique base d’une solution juste et durable » et exhortant les parties à engager des discussions « sans délai » dans ce cadre.[12] Avec un appui occidental (États-Unis, France, Espagne, Royaume-Uni…) et arabe/africain aussi massif, une telle orientation pourrait obtenir une adhésion majoritaire au Conseil – quitte à ce que certains membres persistent à s’abstenir, ce qui n’empêcherait pas l’adoption d’une résolution plus audacieuse.
En définitif, l’effet domino enclenché par l’appui américain à la marocanité du Sahara se traduit par la constitution d’un consensus international croissant autour de l’autonomie. Cette tendance crée une opportunité inédite de multilatéraliser la solution : l’ONU peut capitaliser sur l’élan donné par les États-Unis et les ralliements successifs pour impulser un plan global de sortie de crise. Les multiples voix étatiques favorables envoient d’ores et déjà « un message clair aux Nations Unies » : il est temps de « dépasser les positions figées du passé » et d’entériner une solution pragmatique conforme à l’unité territoriale du Maroc.[13] Reste à savoir si l’ONU saura transformer l’essai diplomatique et traduire cette dynamique en action concrète. C’est tout l’enjeu du passage de la reconnaissance de fait d’une solution, à son adoption officielle dans le cadre onusien.
Agir plutôt qu’attendre : vers une nouvelle doctrine onusienne sur le Sahara ?
Avec un contexte aussi favorable, mais potentiellement volatile, la communauté internationale est placée devant ses responsabilités : agir plutôt qu’attendre. Pour les Nations Unies, cela signifie qu’une nouvelle doctrine, ou du moins une nouvelle approche stratégique, pourrait voir le jour concernant le Sahara marocain. L’idée serait de rompre avec l’attentisme qui a prévalu jusque-là, pour adopter une position plus proactive et cohérente avec la réalité du terrain et le consensus émergent. Quels pourraient être les contours d’une telle doctrine onusienne renouvelée sur le Sahara marocain ?
En premier lieu, il s’agirait d’entériner les principes de réalisme et de compromis comme guides de l’action onusienne, en accord avec les termes mêmes employés par le Conseil de sécurité depuis quelques années. Concrètement, le Secrétaire général et son Envoyé personnel, soutenus par le Conseil, pourraient recentrer explicitement le processus de négociation sur la seule voie réaliste identifiée : celle d’une autonomie sous souveraineté marocaine. Cela implique de clarifier définitivement que l’option d’un référendum d’autodétermination binaire (indépendance ou intégration) n’est plus à l’ordre du jour car inapplicable dans les faits. Cette reconnaissance, déjà perceptible en creux dans les résolutions, pourrait être formulée plus ouvertement dans les communications onusiennes. De même, l’ancien Secrétaire général de l’ONU, Javier Pérez de Cuellar, avait dès la fin des années 1980 suggéré qu’une autonomie négociée pourrait être la solution la plus réalisable pour le Sahara.[14] S’inscrire dans cette veine consisterait pour l’ONU à actualiser son approche du dossier : plutôt que de demeurer le gardien passif d’un cessez-le-feu fragile en attendant un impossible consensus sur l’indépendance, l’ONU deviendrait le facilitateur actif d’un compromis basé sur l’autonomie, déjà largement validé par ses États membres.
En deuxième lieu, adopter une nouvelle doctrine onusienne supposerait d’augmenter l’implication de l’ONU sur le terrain en accompagnant la mise en œuvre de l’autonomie une fois celle-ci agréée politiquement. En d’autres termes, agir signifierait passer d’une présence essentiellement militaire d’observation (la MINURSO surveillant le cessez-le-feu) à une présence politique et institutionnelle de soutien à la solution. Dans cette optique probable et réalisable, l’ONU dispose d’un levier moral et politique puissant : la légitimité internationale. Si elle affirme clairement que l’autonomie sous souveraineté marocaine est l’issue souhaitable, il deviendra de plus en plus difficile pour l’Algérie et le polisario de justifier leur intransigeance, au risque d’apparaître comme les responsables de la prolongation du conflit.
En troisième lieu, agir plutôt qu’attendre implique pour l’ONU de s’adapter aux nouvelles réalités géopolitiques de la région, en intégrant pleinement le Maroc comme acteur central de stabilité et de développement régional. Le Royaume du Maroc, à travers sa proposition d’autonomie et son investissement massif dans le développement de ses provinces sahariennes, a démontré sa volonté de parvenir à une solution pacifique et durable. Il promeut par ailleurs une vision d’intégration régionale, notamment via sa politique africaine et l’Initiative Atlantique Royale, qui offre des perspectives de croissance partagée à l’ensemble du Maghreb et de l’Afrique de l’Ouest.[15] En ce sens, la résolution du conflit du Sahara selon l’approche marocaine bénéficierait non seulement au Maroc, mais aussi à ses voisins et partenaires, en libérant les synergies de coopération aujourd’hui bloquées. Une nouvelle doctrine onusienne devrait donc reconnaître le rôle constructif du Maroc et encourager les initiatives concrètes de développement dans le Sahara qui profitent aux populations locales. Agir maintenant, c’est aussi envoyer un signal fort aux populations concernées, tant celles résidant dans les provinces du Sud que celles retenues dans les camps de Tindouf, qu’une issue politique, stable et bénéfique est en vue. Cela implique de renforcer l’idée, de plus en plus partagée, selon laquelle les dirigeants du polisario apparaissent aujourd’hui déconnectés des réalités du terrain, prisonniers d’un discours figé et inadapté aux attentes actuelles. Leurs revendications séparatistes ne répondent plus aux besoins des populations concernées, souvent livrées à elles-mêmes et privées d’horizons concrets. En contraste, le Maroc poursuit une politique d’investissement structurée dans ses provinces du Sud, fondée sur le développement durable, l’inclusion sociale et la coopération régionale. Dès lors, il devient impératif de proposer des solutions créatives, s’appuyant sur l’autonomie comme cadre, mais ouvertes à une intégration régionale plus large, capable de reconnecter le Sahara à son environnement géographique et humain naturel : l’Afrique de l’Ouest et l’espace atlantique. Cette démarche proactive de l’ONU serait en phase avec l’esprit des récentes déclarations et alignements des grandes puissances. Autrement dit, l’ONU joue sa crédibilité sur ce dossier. Elle a l’occasion, en ce moment précis, de prouver qu’elle sait s’aligner sur la réalité et les besoins du terrain.
Conclusion
La réaffirmation du soutien américain au Plan d’autonomie proposé par le Maroc pour le Sahara intervient à un moment charnière. Elle a déjà contribué à consolider un large front international derrière une solution réaliste et de compromis, isolant les tenants du statu quo. Désormais, une nouvelle dynamique onusienne est possible, on en perçoit les prémices dans l’évolution du langage du Conseil de sécurité et dans la mobilisation de nombreux États membres. Pour la concrétiser, l’ONU est invitée à accepter de sortir de sa réserve et de prendre acte de la nouvelle donne : il n’y aura pas de règlement sans le Plan d’autonomie, et maintenir des ambigüités ne fait que retarder l’inévitable. En adoptant une approche rénovée, une sorte de doctrine du réalisme sur le Sahara marocain, l’ONU peut canaliser l’élan donné par Washington et d’autres capitales et le traduire en progrès tangible vers une paix durable. Il en va de l’intérêt des populations concernées, qui aspirent à tourner la page de ce conflit prolongé. Le Maroc, de son côté, s’affirme prêt à coopérer pleinement dans le cadre onusien. Son attitude conciliante et son initiative d’autonomie offrent à l’ONU une opportunité unique de résoudre enfin ce différend selon un schéma gagnant-gagnant pour l’ensemble des parties. Saisir cette opportunité, c’est enclencher une nouvelle dynamique et redonner espoir à toute une région en quête de stabilité et d’intégration pacifique.
Bibliographie
- Elbasri, A. (2025, 20 avril). Le retrait de la Minurso, un piège dangereux pour le Maroc. Médias24. https://medias24.com/chronique/le-retrait-de-la-minurso-un-piege-dangereux-pour-le-maroc/
- La Rédaction. (2025, 20 avril). Sahara marocain : un consensus international croissant autour de l’initiative d’autonomie. Infos27. https://infos27.cd/2025/04/20/sahara-marocain-un-consensus-international-croissant-autour-de-linitiative-dautonomie/
- Lyammouri, R., & Ammari, F. (2025, 16 avril). Sahara marocain : l’appui américain renouvelé et ses implications régionales. Policy Center for the New South. https://www.policycenter.ma/publications/sahara-marocain-lappui-americain-renouvele-et-ses-implications-regionales
- Lyammouri, R., & Ghoulidi, A. (2024). Morocco’s Atlantic Initiative: A Catalyst for Sahel-Saharan Integration. Policy Center for the New South. https://www.policycenter.ma/publications/moroccos-atlantic-initiative-catalyst-sahel-saharan-integration
- Miyet, B. (2012, 22 mai). Autonomy: The Optimal Political Solution. Middle East Institute. https://www.mei.edu/publications/autonomy-optimal-political-solution
- Nations Unies. (2021, 29 octobre). Résolution 2602 (2021) adoptée par le Conseil de sécurité à sa 8881e séance. https://undocs.org/fr/S/RES/2602(2021);
- Nations Unies. (2022, 27 octobre). Résolution 2654 (2022) adoptée par le Conseil de sécurité à sa 9169e séance. https://undocs.org/fr/S/RES/2654(2022);
- Nations Unies. (2023, 30 octobre). Résolution 2703 (2023) adoptée par le Conseil de sécurité à sa 9432e séance. https://undocs.org/fr/S/RES/2703(2023)
- Nations Unies. (2022, 27 octobre). Sahara occidental : Le Conseil de sécurité proroge jusqu’au 31 octobre 2023 le mandat de la MINURSO (CS/15081). Couverture des réunions & communiqués de presse. https://press.un.org/fr/2022/cs15081.doc.htm
- Oukerzaz, H. (2022, 3 octobre). Sahara : les évolutions un an après l’adoption de la résolution 2602 du Conseil de sécurité. Le Matin. https://lematin.ma/express/2022/sahara-marocain-evolutions-an-ladoption-resolution-2602/381543.html
- Rubin, M. (2025, March 19). To cut waste, eliminate failed UN peacekeeping operations. Washington Examiner. https://www.washingtonexaminer.com/restoring-america/fairness-justice/2951971/to-cut-waste-eliminate-failed-un-peacekeeping-operations/
- Zaaimi, S. (2025, 9 avril). Why it’s time to terminate the UN’s dysfunctional mission in Western Sahara. Atlantic Council. https://www.atlanticcouncil.org/blogs/menasource/why-its-time-to-terminate-the-uns-dysfunctional-mission-in-western-sahara/
[1] Nations Unies. (2021, 29 octobre). Résolution 2602 (2021) adoptée par le Conseil de sécurité à sa 8881e séance. https://undocs.org/fr/S/RES/2602(2021); Nations Unies. (2022, 27 octobre). Résolution 2654 (2022) adoptée par le Conseil de sécurité à sa 9169e séance. https://undocs.org/fr/S/RES/2654(2022); Nations Unies. (2023, 30 octobre). Résolution 2703 (2023) adoptée par le Conseil de sécurité à sa 9432e séance. https://undocs.org/fr/S/RES/2703(2023)
[2] Nations Unies. (2022, 27 octobre). Sahara occidental : Le Conseil de sécurité proroge jusqu’au 31 octobre 2023 le mandat de la MINURSO (CS/15081). Couverture des réunions & communiqués de presse. https://press.un.org/fr/2022/cs15081.doc.htm
[3] Zaaimi, S. (2025, 9 avril). Why it’s time to terminate the UN’s dysfunctional mission in Western Sahara. Atlantic Council. https://www.atlanticcouncil.org/blogs/menasource/why-its-time-to-terminate-the-uns-dysfunctional-mission-in-western-sahara/
[4] Rubin, M. (2025, March 19). To cut waste, eliminate failed UN peacekeeping operations. Washington Examiner. https://www.washingtonexaminer.com/restoring-america/fairness-justice/2951971/to-cut-waste-eliminate-failed-un-peacekeeping-operations/
[5] Elbasri, A. (2025, 20 avril). Le retrait de la Minurso, un piège dangereux pour le Maroc. Médias24. https://medias24.com/chronique/le-retrait-de-la-minurso-un-piege-dangereux-pour-le-maroc/
[6] Nations Unies. (2022, 27 octobre). Sahara occidental : Le Conseil de sécurité proroge jusqu’au 31 octobre 2023 le mandat de la MINURSO (CS/15081).
[7] Zaaimi, S. (2025, 9 avril). Why it’s time to terminate the UN’s dysfunctional mission in Western Sahara.
[8] Lyammouri, R., & Ammari, F. (2025, 16 avril). Sahara marocain : l’appui américain renouvelé et ses implications régionales. Policy Center for the New South. https://www.policycenter.ma/publications/sahara-marocain-lappui-americain-renouvele-et-ses-implications-regionales
[9] La Rédaction. (2025, 20 avril). Sahara marocain : un consensus international croissant autour de l’initiative d’autonomie. Infos27. https://infos27.cd/2025/04/20/sahara-marocain-un-consensus-international-croissant-autour-de-linitiative-dautonomie/
[10] Idem.
[11] Oukerzaz, H. (2022, 3 octobre). Sahara : les évolutions un an après l’adoption de la résolution 2602 du Conseil de sécurité. Le Matin. https://lematin.ma/express/2022/sahara-marocain-evolutions-an-ladoption-resolution-2602/381543.html
[12] Lyammouri, R., & Ammari, F. (2025, 16 avril). Sahara marocain : l’appui américain renouvelé et ses implications régionales.
[13] La Rédaction. (2025, 20 avril). Sahara marocain : un consensus international croissant autour de l’initiative d’autonomie. Infos27.
[14] Miyet, B. (2012, 22 mai). Autonomy: The Optimal Political Solution. Middle East Institute. https://www.mei.edu/publications/autonomy-optimal-political-solution
[15] Lyammouri, R., & Ghoulidi, A. (2024). Morocco’s Atlantic Initiative: A Catalyst for Sahel-Saharan Integration. Policy Center for the New South. https://www.policycenter.ma/publications/moroccos-atlantic-initiative-catalyst-sahel-saharan-integration