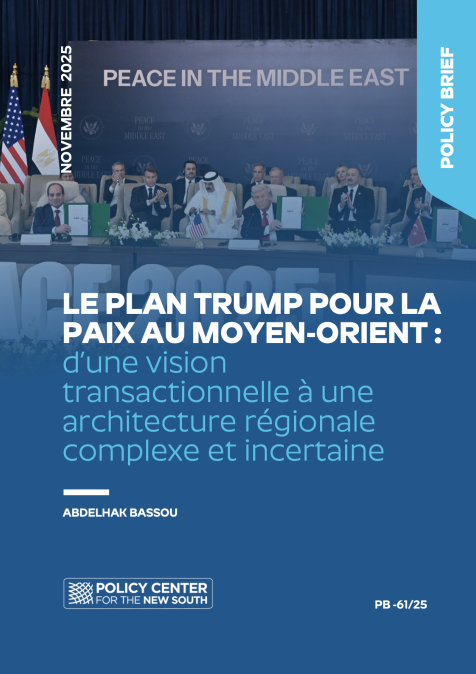Publications /
Policy Brief
Le 17 novembre 2025, le Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies (ONU) a adopté la résolution 2803 par laquelle il fait sien le Plan d’ensemble du Président Donald Trump ayant pour objectif de mettre fin au conflit à Gaza. Contrairement à ce qu’on pourrait croire, l’initiative américaine ne date pas du 2ème mandat de l’Administration Trump. Elle a vu le jour durant son premier mandat.
Le Plan entériné par la résolution du Conseil de sécurité de l’ONU, surnommé ‘’ Deal of the Century ‘’, est en fait l’héritier du plan initial qui portait le nom ‘’ Peace to Prosperity’’. La mouture du plan consacrée par la résolution 2803 peut être considérée est à la fois comme une continuité et une rupture avec l’initiale : une continuité, dans la mesure où elle se focalise sur la paix, et une rupture, dans le sens où il y est question d’une paix instaurée par la force et non par l’attrait de la prospérité.
La réunion avec des leaders arabes et musulmans en marge de l’Assemblée générale des Nations Unies semble avoir convaincu le Président Trump que toute paix au Moyen-Orient doit passer par le politique et le sécuritaire, plutôt que par une transaction économique ou financière.
Ainsi, le plan initial n’a pas disparu, et le nouveau n’est pas une création.
Trump a été obligé d’adapter sa conception de la paix pour sauvegarder sa politique au Moyen-Orient.
Introduction
Dans l’après-midi du 17 novembre 2025, le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté, par 13 voix pour et 2 abstentions (Fédération de Russie et Chine), la résolution 2803 par laquelle il fait sien le Plan d’ensemble du Président Donald Trump ayant pour objectif de mettre fin au conflit à Gaza.
Les idées du Président américain relatives au Moyen-Orient ne datent pas de son deuxième mandat et ne peuvent, donc, se réduire au Plan signé à Sharm Al Cheikh, en Égypte, le 13 octobre 2025, et qui vient d’être entériné par le Conseil de sécurité.
Lors de son premier mandat, le Président Trump avait déjà présenté un plan dit ‘’Deal of the Century ‘’ qui, selon ses promoteurs, devait ouvrir une nouvelle ère de paix entre Israéliens, Arabes et Palestiniens.
Censé résoudre un conflit vieux de plus de soixante-dix ans, le ‘’ Deal of the Century ‘’ a surtout marqué une inflexion durable de la politique américaine au Moyen-Orient : celle d’une diplomatie fondée sur la transaction, la normalisation et la puissance économique plutôt que sur la légitimité politique et le droit international.
Le Plan, qui s’adossait au projet intitulé ‘’Peace to Prosperity’’[1], avait été conçu par Jared Kushner, gendre du Président. Il promettait, certes, de transformer le Moyen-Orient en une zone de prospérité partagée, mais cette paix proposée par Kushner et qui devait conduire à la prospérité, s’avère ne pouvoir se réaliser qu’au prix de concessions jugées douloureuses par les Palestiniens et quasiment inacceptable pour les Arabes et Musulmans. Il fut dénoncé par l’Autorité palestinienne comme une manœuvre destinée à institutionnaliser l’occupation israélienne sous couvert de paix. Mahmoud Abbas balaie le Plan d’un revers de main: « Jérusalem n’est pas à vendre et nos droits ne sont pas à marchander. »[2]
Le Plan reposait sur une philosophie typiquement inscrite dans le style de pensée du Président américain : la paix comme transaction et non comme processus politique. Loin de rétablir une équité historique, le Plan se proposait de transformer le rapport de force en un marché gagnant-gagnant, conditionné par l’acceptation du primat d’Israël comme puissance régionale stabilisatrice et le report sine die de toute idée d’État palestinien.
D’aucuns pensaient que ce Plan allait être enterré après la défaite de Trump en 2020 ; Ils ont été démentis par les faits. Les fondements conceptuels de la pensée de Trump sur le Moyen-Orient ont pu survivre. L’administration Biden n’avait, en effet, constitué qu’une parenthèse dans la vie du Plan. Tout en affichant une posture plus multilatérale, et en mettant en veilleuse les aspects économiques du Plan, les Démocrates ont réactivé plusieurs de ses piliers, notamment la priorité donnée à la pacification de Gaza (où la guerre a éclaté en 2023), à la consolidation des accords d’Abraham ( sans y mettre beaucoup d’enthousiasme) et à l’élargissement de la coalition régionale anti-iranienne (sans y parvenir).
Quand Donald Trump retourne à la Maison-Blanche en 2025, il tient toujours à son deal du siècle. Il a tout tenté pour convaincre que la prospérité pouvait apporter la paix (faire de Gaza le Singapour ou la Rivera du Moyen-Orient) ; mais il a dû plier, ensuite, pour transformer son projet en une démarche, toujours transactionnelle, mais qui tient compte de l’équité politique, du sens historique et juridique et d’une opinion publique internationale qui accorde peu ou pas de crédit aux soucis économiques et à la prospérité quand il s’agit des droits des Palestiniens.
En effet, la conjoncture au Moyen-Orient et dans le monde a changé. La guerre à Gaza, qui a éclaté en octobre 2023, a transformé la donne. Israël, sujet central dans le projet de Donald Trump, a disproportionnellement répondu aux attaques du 7 octobre et son image s’est dégradée dans l’opinion publique internationale ; elle passe d’une figure de victime à celle de bourreau. La priorité devient, alors, d’arrêter la guerre avant de chercher la richesse. Trump est, ainsi, obligé d’adapter sa conception de la paix, pour sauvegarder sa politique au Moyen-Orient, tout en redorant le blason d’Israël dont l’isolement est de plus en plus marqué, surtout, après l’attentat manqué contre la délégation du Hamas au Qatar. La réunion avec des leaders arabes et musulmans en marge de l’Assemblée générale des Nations Unies achève de le convaincre que toute paix au Moyen-Orient passe plutôt par le politique et le sécuritaire, que par une transaction économique ou financière.
Comme rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, l’ancien plan du président Trump n’a pas disparu, et le nouveau n’est pas une création. D’ailleurs la résolution 2803 de 2025 qui porte le nouveau Plan ne manque pas de faire référence, dans son paragraphe 2, aux convictions exprimées à ce propos par le président Trump en 2020.[3]
En effet, l’idée de 2019 s’est seulement transformée en une matrice d’action géopolitique et sécuritaire, d’abord, dans l’espoir de devenir géoéconomique, ensuite. La prospérité qui doit créer la paix doit avoir celle-ci comme préalable. Il faut avant tout imposer la paix par la force et la diplomatie avant d’entamer les transactions censées amener la prospérité.
Le Plan de l’Administration Trump de 2025 n’est, donc, pas nouveau, il s’inscrit dans la doctrine amendée du président et prend le nom de ‘’Peace through strength’’, mêlant pressions bilatérales, incitations économiques et diplomatie personnelle. Il est l’héritier du projet ‘’ Peace to Prosperity’’ que le président américain avait initié lors de son premier mandat. Il en constitue, à la fois une continuation et une rupture. Il est une continuité en se focalisant sur la paix ; et il est une rupture dans la mesure où c’est une paix instaurée par la force et non par l’attrait de la prospérité.
C’est ainsi qu’à Sharm Al Cheikh, Trump impose la paix en exerçant des pressions sur Israël et en menaçant Hamas. Il prétend même que ce sont les frappes israélo-américaines sur l’Iran qui ont facilité le cessez-le-feu à Gaza. Il signe et fait signer à l’Égypte, au Qatar, et à la Turquie un plan qui semble oublier le deal du siècle, mais qui, en réalité, ne fait que lui préparer le terrain. La paix est signée en l’absence des belligérants ; Hamas et Israël sont condamnés, par contumace à cesser les hostilités.
Le plan signé à Sharm Al Cheikh ambitionne de faire passer un compromis imposé capable de faciliter la paix et potentiellement la prospérité.
Le plan semble viser trois objectifs, censés préparer le Moyen-Orient à une ère de coopération et de prospérité :
une démarche immédiate: la pacification de la bande de Gaza ;
une perspective possible mais incertaine : résoudre le conflit entre Palestiniens et Israéliens ;
couronner les efforts du premier mandat : élargir la paix en étendant les Accords d’Abraham.
Ce sont ces trois objectifs qui constitueront l’ossature de ce Policy Brief.
1- Une démarche immédiate : la pacification de la bande de Gaza
Le cœur du plan initial du président Trump reposait sur l’idée que la prospérité est un préalable à la paix. Jared Kushner, son gendre et principal conseiller, concevait la paix non comme un compromis politique, mais comme un investissement collectif. Lors de la conférence de Manama (Bahreïn, juin 2019), il présenta un plan économique de 50 milliards de dollars pour financer infrastructures, commerce et innovation dans les territoires palestiniens et les pays voisins (Égypte, Jordanie, Liban).
Cette approche négligeait toutefois la dimension politique du conflit. L’hypothèse implicite était qu’une population mieux intégrée à l’économie mondiale deviendrait plus disposée à la stabilité, même sans souveraineté pleine et entière.
Lorsque la guerre de Gaza éclate en octobre 2023, et que Donald Trump reprend le pouvoir en janvier 2025, cette logique est réactivée sous une autre forme. Washington considère que la fin de la guerre est le premier étage d’un nouvel édifice régional et le préalable à tout effort pour une coopération économique générant de la prospérité. Le cessez-le-feu devient non pas la conclusion d’un accord, mais le point de départ d’une recomposition politique, condition sine qua non d’une éventuelle démarche vers une normalisation économique.
1- L’après-guerre à Gaza : un enjeu de gouvernance d’abord
Depuis la fin de 2023, et l’ancrage dans la conscience de tous, que le Hamas ne pouvait en aucun cas gouverner Gaza après la guerre, les discussions sur l’avenir de ce territoire oscillent entre trois modèles :
un retour encadré de l’Autorité palestinienne sous supervision arabe (Égypte, Arabie saoudite, Qatar, Émirats) ;
une administration internationale intérimaire, éventuellement pilotée par l’ONU, avec un mandat humanitaire et sécuritaire (ce que le Conseil de sécurité a finalement retenu et décidé) ;
une gestion indirecte par Israël, via des zones tampons et une surveillance militaire accrue.
Mais Tel-Aviv rejette toute présence de l’Autorité palestinienne. Le Premier ministre Benyamin Netanyahu déclarait en janvier 2024: « Israël n’autorisera pas un Hamas 2.0 ou une autorité palestinienne 1.0 à Gaza. »
Cette intransigeance rend difficile tout règlement politique. Pour Israël, l’objectif est la neutralisation totale du Hamas, non une transition démocratique. Les États-Unis, eux, cherchent un équilibre pragmatique : éviter une vacance du pouvoir à Gaza sans réhabiliter un Hamas discrédité.
2- Les acteurs régionaux : entre prudence et calcul
L’Égypte joue un rôle pivot mais redoute une déstabilisation du Sinaï. Le président Abdel Fattah Al-Sissi avertit dès novembre 2023: « Nous ne permettrons pas que la cause palestinienne soit résolue aux dépends de la sécurité de l’Égypte. »
Le Qatar, quant à lui, se positionne comme médiateur et financeur, mais aussi comme protecteur des cadres du Hamas. La Jordanie, pour sa part, maintient sa ligne de défense du statu quo à Jérusalem. Enfin, l’Arabie saoudite reste en retrait, conditionnant toute implication à une perspective politique sérieuse. L’ONU et l’Union européenne rappellent que toute solution durable doit s’ancrer dans le droit international, en particulier les résolutions 242 et 338 du Conseil de sécurité.
La fin de la guerre à Gaza constitue ainsi un objectif commun mais avec des motivations divergentes :
l’objectif d’Israël est sécuritaire. La paix pour Tel-Aviv s’identifie à une situation stratégique où sa capacité de dissuasion est ressentie et intériorisée par tous ses voisins ;
les États-Unis visent à travers la paix une situation où les pays de la région abandonnent toute belligérance pour abonder vers plus de coopération et de cohabitation dans la stabilité. Une normalisation entre les États arabo-musulmans de la région et Israël constitue un rempart contre les stratégies de nuisance de l’Iran, ce qui pourrait amener cette dernière à revoir sa doctrine ;
les pays arabes privilégient la légitimité selon le droit international. Ils usent de toutes leurs capacités pour recouvrer ce qu’ils considèrent comme un droit légitime ; celui pour les Palestiniens d’être maîtres de leur destin. Cette solution permettrait de tirer le tapis sous les pieds de l’Iran qui instrumentalise la question palestinienne pour asseoir son influence dans la région.
2. Résoudre le conflit entre Palestiniens et Israéliens : une perspective possible mais incertaine
1- Le Plan Trump : une formule ambigüe d’État palestinien sous tutelle
Le plan initial proposé lors du premier mandat du président Trump proposait une forme d’État palestinien démilitarisé, fragmenté et constitué d’enclaves reliées par des routes et tunnels, avec une capitale à Abou-Dis (nouvelle ville près de Jérusalem). Jérusalem restant la capitale « indivisible » d’Israël. En échange, Washington promettait un soutien financier massif et une reconnaissance internationale progressive.
Cette proposition, contraire aux résolutions onusiennes, fut rejetée unanimement par les Palestiniens. Elle réduisait la question palestinienne à un problème de gouvernance et d’aide internationale. Le déplacement de l’ambassade américaine à Jérusalem (mai 2018) confirma que les États-Unis s’étaient alignés sur la lecture israélienne du conflit.
Sous le deuxième mandat de Trump, les États-Unis remettent la question de l’État palestinien à plus tard. Ils font de la fin de l’état de guerre dans la région une priorité et un préalable à la résolution du conflit qui oppose Israël aux Arabes, aux Musulmans et aux Palestiniens. Contrairement à la communauté arabo-musulmane et à certains européens, qui font de la question palestinienne la pierre angulaire de la paix au Moyen-Orient, les États-Unis et Israël la conçoivent comme une conséquence d’une reconfiguration de la région. Les Américains et les Israéliens tiennent dans un premier temps à neutraliser l’axe iranien qui, pour eux, entrave toute solution au conflit israélo-palestinien.
2- L’initiative franco-saoudienne : complémentaire ou rivale du Plan Trump ?
Depuis 2024, Paris et Riyad tentent de réactiver la dynamique de paix en la sortant du tête-à-tête Washington–Tel-Aviv.
Lors de la Conférence de Paris sur la Paix (décembre 2023), le Président français Emmanuel Macron affirma qu’: « Aucune paix durable ne peut exister sans un État palestinien. »
Le prince héritier Mohammed ben Salmane, par la voix de son ministre des Affaires étrangères, rappela que : « La normalisation avec Israël est impossible sans une avancée réelle pour les Palestiniens. »
La démarche franco-saoudienne vise à repositionner le monde arabe comme acteur de paix, et non comme un simple spectateur d’un agenda américain. Riyad, qui est restée loin des médiations au profit du Qatar et de l’Égypte, y voit aussi une opportunité de réhabiliter son leadership régional, tout en préparant à long terme une normalisation encadrée.
La France, également tenue à l’écart des efforts de médiation durant la guerre de Gaza, a tenté de s’y insérer en reconnaissant l’État palestinien au prix d’une dégradation de ses relations avec Israël. Elle trouve dans l’initiative, qu’elle conduit avec l’Arabie saoudite, un moyen de se mettre à la table des négociations finales.[4]
3- Les obstacles structurels
Le Plan Trump, qui marque un retour du politique pour la résolution du conflit moyen-oriental, semble réussir dans son avant-première étape.[5] Il reste cependant fragile. Des facteurs structurels menacent sa pérennité. La coalition israélienne (Likoud et extrême droite) rejette toute concession territoriale. Cette coalition développe une vision biblique du « Grand Israël » et affiche publiquement son opposition à toute idée de création d’un État palestinien. La division palestinienne (Hamas/Fatah) crée un conflit fratricide dans le conflit central et gêne les efforts de création d’un État palestinien. Le passé sanglant entre les deux factions semble résister aux efforts de réunification. De plus, le Plan du président Trump doit être soutenu et renforcé par la communauté internationale ; or cette dernière semble de plus en plus se fatiguer diplomatiquement. Aura-t-elle la force de poursuivre et d’accompagner l’effort américain jusqu’au bout ?
4- La résolution 2803 et les ambiguïtés sur la question palestinienne
L’acceptation de la résolution par tous (Israël et États arabes) ne devait ni assurer la création future d’un État palestinien (comme le veulent les Arabes) ni ignorer la question (comme le veut Israël) ; en s’éloignant des ambitions de tous et en restant dans une ambiguïté nébuleuse, elle fait allusion à l’ouverture d’un chemin et à l’instauration d’un dialogue qui ouvriraient la voie à un État palestinien, le tout conditionné par des réformes de l’Autorité palestinienne.[6] Rien n’est cependant moins sûr ; la résolution souligne que lorsque l’Autorité palestinienne aura réalisé les réformes demandées, les conditions d’entamer les démarches pour la création de l’État palestinien seraient, peut-être, réunies. L’utilisation du « peut-être » pose beaucoup de doute sur cette création.
3- Couronner l’effort du premier mandat : élargir les Accords d’Abraham
1- Les Accords d’Abraham : la paix sans les Palestiniens
Les Accords d’Abraham (2020-2021) ont permis la normalisation entre Israël et plusieurs États arabes.
Ils incarnent le cœur du Plan Trump : remplacer la paix arabo-palestinienne par une intégration régionale fonctionnelle ou, du moins, assurer à la relation entre les deux un statut de paix provisoire qui pourrait amener à une paix définitive. Pour le président Trump, les relations paisibles entre Israël et les États arabes peuvent relativiser la demande pressante de l’établissement d’un État palestinien ou, du moins, la reporter.
Washington considère ces Accords comme une réussite stratégique. Antony Blinken, ancien Secrétaire d’État américain, déclarait en mars 2024 : “Our goal is not only to consolidate the Abraham Accords but to make them a bridge to a wider peace.” Comme toutes les déclarations des officiels américains, celle de Blinken reflète le flou que les États-Unis ne cessent d’entretenir autour de la question palestinienne. S’il est vrai que les Accords d’Abraham peuvent être un pont vers la paix, la nature de celle-ci n’est pas précisée. S’agit-t-il d’une paix qui inclut les Palestiniens ou d’une pacification qui les marginalise ? Dans l’esprit des pays arabes qui ont signé les Accords d’Abraham, il n’est point question d’oublier la question palestinienne, mais de la faire évoluer en instaurant une relation paisible avec Israël.
2- L’objectif saoudien
L’un des pays arabes que les efforts du Président Trump n’ont pas pu faire adhérer lors de son premier mandat est l’Arabie saoudite. Celle de Biden a poursuivi l’effort sans parvenir à un résultat notable. Si des négociations tripartites Washington–Riyad–Tel-Aviv étaient avancées en septembre 2023, elles ont, cependant, buté sur les exigences de Riyad, notamment les garanties de défense américaines ; le support américain pour un programme nucléaire civil sous contrôle et des gestes concrets envers les ambitions des Palestiniens. La guerre à Gaza a suspendu ces pourparlers, mais la résolution 2803 leur réouvre la porte. Il n’est, alors, pas étonnant qu’au lendemain de l’adoption de la Résolution, le Prince héritier d’Arabie saoudite entame une visite officielle à Washington durant laquelle les Accords d’Abraham et la satisfaction d’autres demandes saoudiennes seront à l’ordre du jour, après que la résolution ait, en partie, répondu aux exigences du Royaume saoudien.
La Résolution 2803, et son cadre de référence, le Plan du président Trump, ne peuvent sans doute pas être ignorés en tant qu’initiatives qui, non seulement, mettent fin à une guerre atroce qui a fait des dizaines de milliers de morts parmi les civils, mais également comme une démarche qui sème des grains de la paix dans la région. Le chemin n’est cependant pas moins long pour effacer des décennies de colère, de haine et d’animosité non seulement entre Israéliens et Palestiniens, mais aussi entre Israël et tous ses voisins.
Entre Israël et la Syrie beaucoup reste à faire, de même qu’entre Tel-Aviv et Beyrouth ; sans parler de la complexité du double conflit opposant, de manière ouverte, Israël à l’Iran, et de manière moins découverte, l’Iran aux pays arabes de la région. Les trois ans qui restent du mandat du Président Trump suffiront-ils pour venir à bout des difficultés qui demeurent ? En tout cas, l’actuel locataire de la Maison-Blanche a mis la barre haut pour son successeur.
[1] Le plan présenté par Jared Kushner est un investissement de 50 milliards sur une période de dix ans qui devait principalement être injecté en Cisjordanie et dans la bande de Gaza.
[2] Mahmoud Abbas, président de l'Autorité palestinienne, répète ici une expression récurrente dans ses discours, notamment lors de son intervention à l'Assemblée générale des Nations Unies en 2018.
[3] Traitant de l’Autorité palestinienne et de son éventuelle future reprise en main de la bande de Gaza, le paragraphe 2 de la résolution : « Salue la création du Conseil de paix, à savoir une administration transitoire dotée de la personnalité juridique internationale et chargée de guider la reconstruction de Gaza et d’en coordonner le financement conformément au Plan d’ensemble et dans le respect des principes juridiques internationaux en vigueur, et ce, jusqu’à ce que l’Autorité palestinienne ait mené à bonne fin son programme de réformes comme prévu dans diverses propositions, notamment le plan de paix de 2020 du Président Trump et l’initiative franco-saoudienne, et qu’elle puisse reprendre le contrôle de Gaza en toute sécurité et dans de bonnes conditions… »
[4] La France et l’Arabie saoudite ont été invitées au sommet de Sharm El Cheikh pour la signature de l’accord conclu conformément au plan du Président Trump.
[5] Les deux belligérants dans la guerre de Gaza ont accepté un premier accord stipulant la relaxe de tous les otages israéliens contre 2000 prisonniers palestiniens, le retrait des forces israéliennes derrière une certaine ligne dans la bande de Gaza et la reprise des convois humanitaires.
[6] Le même paragraphe 2 de la résolution souligne qu’ : « Une fois que l’Autorité palestinienne aura scrupuleusement exécuté son programme de réformes et que la reconstruction de Gaza aura progressé, les conditions seront alors peut-être réunies pour que s’ouvre un chemin crédible vers l’autodétermination palestinienne et la création d’un État palestinien. Les États-Unis instaureront un dialogue entre Israël et les Palestiniens pour qu’ils conviennent d’un horizon politique au service d’une coexistence pacifique et prospère. »