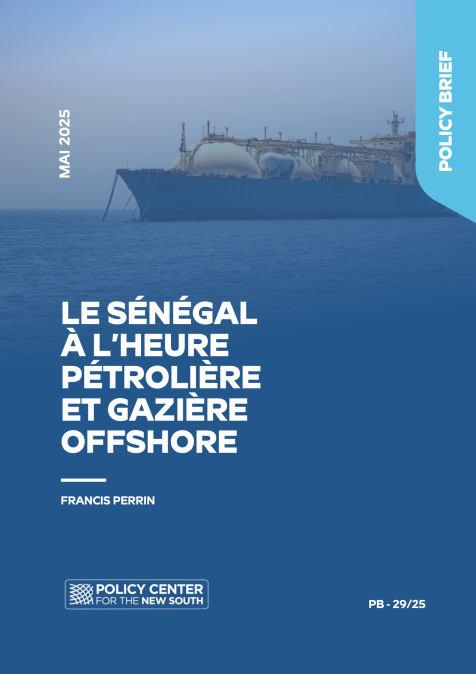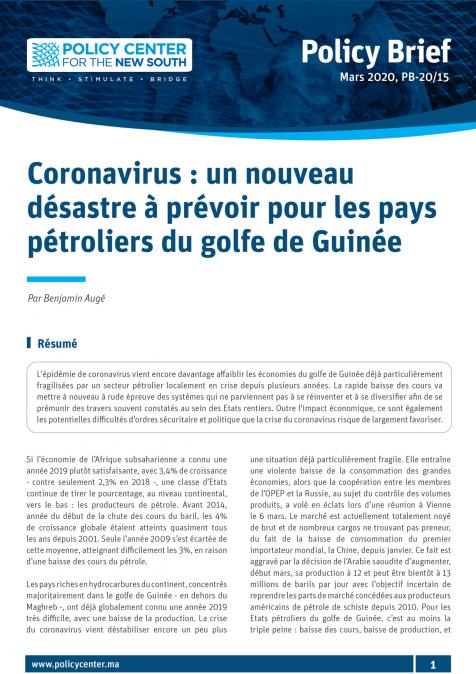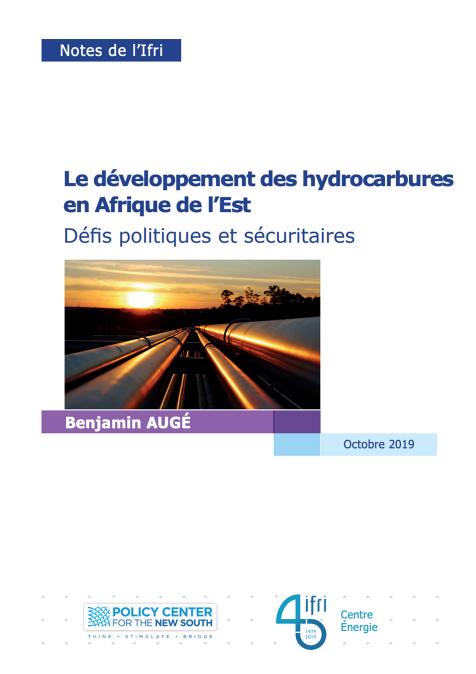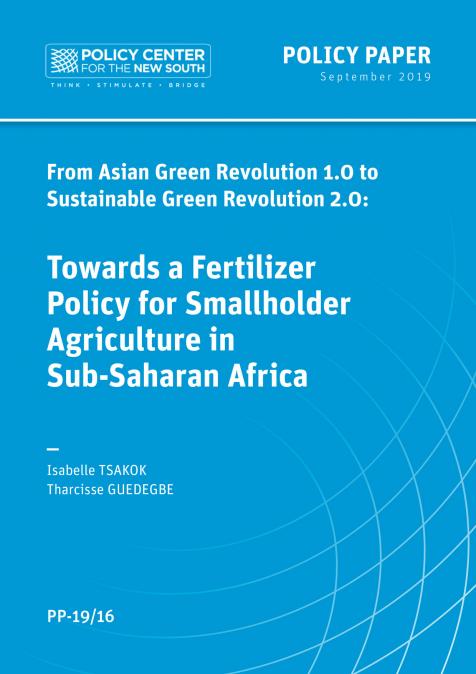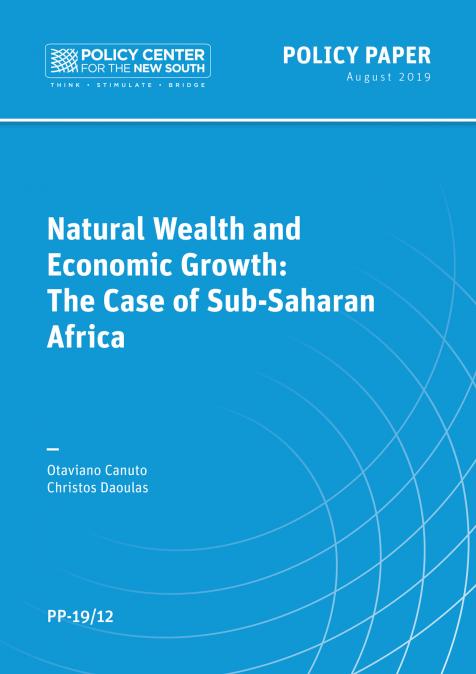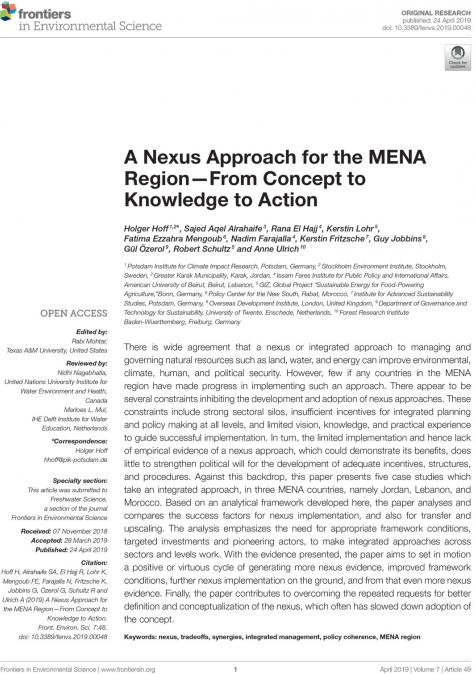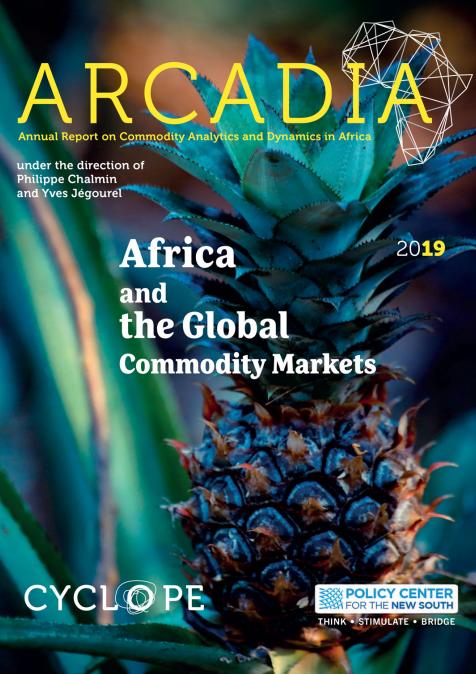Publications /
Policy Brief
Le 17 avril 2025, le géant britannique BP a annoncé qu’une première cargaison de gaz naturel liquéfié (GNL) avait été exportée à partir de ressources gazières exploitées au large du Sénégal et de la Mauritanie. Ces deux pays sont devenus, pour la première fois dans leur histoire, des exportateurs de GNL. Précédemment, il y avait eu trois autres dates particulièrement marquantes dans la valorisation des hydrocarbures dans cette zone. Fin décembre 2024, la production de gaz naturel offshore avait débuté au large de ces deux pays. En février 2025 débutait la production de GNL. Et, auparavant, en juin 2024, le Sénégal était devenu un pays producteur de pétrole offshore.
Un projet pétrolier (Sénégal) et un projet gazier (Sénégal/Mauritanie)
Ces quatre dates clés pour le Sénégal sont liées à deux projets énergétiques distincts : un projet de production et d’exportation de pétrole au large du Sénégal, la Phase 1 de Sangomar, et un projet de production de gaz naturel et d’exportation de GNL au large du Sénégal et de la Mauritanie, Greater Tortue Ahmeyim (GTA). Ces deux projets présentent plusieurs points communs :
- les découvertes initiales qui ont débouché sur ces deux projets remontent à 2014-2015 (2014 pour le pétrole et 2015 pour le gaz). Il a donc fallu, dans ces deux cas, dix ans entre les premières découvertes et la mise en production, ce qui est assez classique dans l’industrie des hydrocarbures ;
- le pétrole et le gaz sont produits en offshore (sous l’océan Atlantique) ;
- les découvertes ont été réalisées par des compagnies privées étrangères ;
- ces compagnies sont anglo-saxonnes : une entreprise américaine Kosmos Energy, pour le gaz, et une firme britannique, Cairn Energy, pour le pétrole ;
- ces entreprises ne sont pas des compagnies pétrolières de premier plan. Elles font partie d’une catégorie de l’industrie pétrolière que l’on appelle historiquement les indépendants (par opposition aux Majors, qui sont les plus grandes sociétés pétrolières privées) ;
- les deux entreprises qui ont réalisé les découvertes initiales ne sont pas les opérateurs (chefs de file des consortiums) actuels des deux projets. Cairn Energy s’est retirée du projet pétrolier et Kosmos Energy s’est associée à BP qui est devenu l’opérateur du projet gazier ;
- ces deux projets sont de grande taille en termes de réserves et de production mais le projet gazier est le plus important d’entre eux ;
- des retards dans le développement de ces projets ont été enregistrés, ce qui n’est pas très surprenant du fait, notamment, de la pandémie de la Covid-19, en 2020, qui a eu un impact négatif sur beaucoup de gros projets industriels. Les mises en production auraient dû intervenir en 2023 ou 2024 ;
- dans les deux cas, ce n’est pas la fin de l’histoire. Pour Sangomar et GTA, les mises en production en 2024 et en 2025 respectivement entrent dans le cadre d’une première phase, ce qui signifie qu’il y aura une suite. À ce jour, on dispose d’informations assez précises sur la Phase 2 de GTA et on sait également qu’elle ne sera pas la dernière. Pour Sangomar, c’est plus flou pour le moment.
Phase 1 de Sangomar
La capacité de production de la Phase 1 de Sangomar est de 100 000 barils par jour (b/j) de brut grâce au FPSO (unité flottante de production, de stockage et de déchargement) Léopold Sédar Senghor, appelé ainsi en hommage au premier président de la République du Sénégal qui est un pays indépendant depuis 1960. Le projet, qui produit à pleine capacité depuis plusieurs mois, est le premier projet pétrolier offshore au Sénégal. Situé à environ 100 kilomètres de la côte, le FPSO a une capacité de stockage de 1,3 million de barils de pétrole. L’opérateur du projet est la firme australienne Woodside Energy et son partenaire est la Société des Pétroles du Sénégal, Petrosen. Les deux firmes sont associées au sein d’une joint-venture, Rufisque Offshore, Sangomar Offshore, and Sangomar Deep Offshore (RSSD), qui détient plusieurs blocs dans l’Atlantique.
Woodside, qui détient une participation de 82 % dans la zone d’exploitation (et de 90 % dans la zone d’évaluation), a indiqué que le coût de la Phase 1 restait dans la fourchette prévue de U.S.$4,9-5,2 milliards. Sangomar s’étend sur plus de 400 km² par des profondeurs d’eau comprises entre 700 et 1 400 mètres. Le réservoir, qui contient du pétrole et du gaz naturel, est à environ 2 kilomètres sous le fond de la mer. La décision finale d’investissement pour la Phase 1 de Sangomar avait été prise en janvier 2020 et la campagne de forages avait débuté en juillet 2021.
Vingt-quatre puits seront forés pour la Phase 1. Sur ces 24 puits, 12 seront des forages de production, 10 des puits injecteurs d’eau et deux des puits injecteurs de gaz. La réinjection permettra de maximiser la production de brut. Woodside avait indiqué en mai 2023 que la Phase 1 reposait sur des réserves de 230 millions de barils. Le brut est d’une densité de 31° API environ. Depuis juin 2024, le pétrole a été principalement vendu en Chine, en Europe et aux États-Unis et une partie est livrée au Sénégal pour y être raffinée sur place. La production de gaz naturel débutera ultérieurement.
Phase 1 de GTA
La décision finale d’investissement pour la Phase 1 du projet GTA a été prise en décembre 2018. Les deux pays concernés ont accepté de se partager les ressources gazières au large de leurs côtes sur une base paritaire (50%-50%). Le consortium qui développe et exploite GTA est composé de BP (opérateur, 56 %), Kosmos Energy (27 %), Petrosen (10 %) et la Société mauritanienne des hydrocarbures (SMH, 7%), soit deux sociétés privées et deux compagnies étatiques. La Phase 1 a une capacité de production de GNL de 2,4 millions de tonnes par an (Mt/an). Une seconde phase est en cours de préparation et elle portera la capacité du projet à près de 5 Mt/an. Avec une troisième phase, GTA pourrait permettre d’exporter de l’ordre de 10 Mt/an de GNL.
Tout le projet GTA est offshore. Le gaz est produit à environ 120 kilomètres des côtes par de très grandes profondeurs d’eau (jusqu’à 2 850 mètres) ; il est transféré vers un FPSO pour traitement et séparation du gaz et des liquides ; il est ensuite transporté vers une unité flottante de liquéfaction (Floating LNG – FLNG). Toute la production est commercialisée par BP Gas Marketing, qui est le seul acteur au sein du consortium à avoir une expertise dans le domaine du GNL. Une partie du gaz produit sera livrée au Sénégal et à la Mauritanie.
Avec le Sénégal et la Mauritanie, le continent africain compte à présent dix pays exportateurs de GNL. Les huit autres sont l’Algérie et l’Égypte, en Afrique du Nord, le Mozambique, en Afrique de l’Est, et le Nigeria, l’Angola, le Congo (République du Congo), la Guinée Equatoriale et le Cameroun, sur la côte occidentale de l’Afrique.
Le « PASTEF » face aux défis pétroliers, gaziers et économiques
Les dirigeants du Sénégal, qui proviennent du PASTEF (Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l’éthique et la fraternité), Bassirou Diomaye Faye, président de la République, et Ousmane Sonko, premier ministre, tous les deux au pouvoir depuis avril 2024, n’avaient pas ménagé leurs critiques contre les contrats pétroliers et gaziers conclus lors des mandats du président précédent, Macky Sall (2012-2024). Pour les nouveaux dirigeants du pays, ces contrats sont beaucoup trop favorables aux intérêts étrangers. Ils avaient indiqué qu’ils entendaient les renégocier pour qu’ils soient plus rémunérateurs pour l’État sénégalais. Cette volonté se heurte cependant à de dures réalités : le projet pétrolier et le projet gazier offshore sont entrés en production ; chacun d’entre eux a nécessité des milliards de dollars d’investissements ; ceux-ci ont été très largement financés par des compagnies pétrolières étrangères ; et il est très peu probable que l’État obtienne gain de cause dans une procédure d’arbitrage international. Le Sénégal pourra évidemment durcir à son avantage les conditions contractuelles pour l’attribution de futurs permis mais sa marge de manœuvre pour Sangomar et pour GTA est très mince.
Lors de son discours au moment du début de la production pétrolière, à la fin juin 2024, le président Bassirou Diomaye Faye avait assuré les Sénégalais de son engagement et de celui du gouvernement à mener une gestion transparente et équitable des ressources naturelles au bénéfice du peuple. Il avait ajouté qu’il voulait « rester lucide et dire que ce qui en sera tiré, quelle que soit la proportion, sera administré au profit des générations actuelles et des générations futures et sera administré par le gouvernement en bon père de famille ». Le chef de l’État avait donc mis l’accent sur quatre points clés en matière d’exploitation des ressources naturelles : une gestion prudente, la transparence, l’équité et la prise en compte des générations futures. Un très bon programme qu’il faudra évidemment concrétiser. Mais le président du Sénégal avait également fait passer un message clair en soulignant qu’il fallait faire preuve de « lucidité » et administrer au mieux les recettes qui seront versées à l’État, « quelle que soit la proportion ». Celle-ci sera très faible en pourcentage des revenus générés par l’exploitation pétrolière et gazière mais, en valeur absolue et pour un pays en développement comme le Sénégal, avec un produit intérieur brut (PIB) estimé à $30,85 milliards en 2023, les sommes en jeu sont importantes. En 2024, la Banque mondiale (BM) avait estimé que les recettes budgétaires liées au pétrole et au gaz pourraient ajouter 1% supplémentaire de produit intérieur brut en moyenne entre 2024 et 2045. La croissance du PIB du pays a été de 6 % en 2024 et le Fonds monétaire international (FMI) prévoit une hausse de 8,4 % en 2025.
Outre l’impact sur la croissance économique, les hydrocarbures pourraient avoir d’autres conséquences positives. Avec le gaz naturel, il sera possible de produire plus d’électricité dans des centrales thermiques à un coût plus compétitif, ce qui sera bon pour les consommateurs, pour les industriels et pour l’économie dans son ensemble. L’obtention de l’objectif du Sénégal d’accès universel à l’énergie sera évidemment facilitée avec une production nationale d’hydrocarbures. Le secteur des hydrocarbures peut aussi offrir des opportunités intéressantes pour des entreprises locales en termes de fournitures et de sous-traitance.
Pour le gaz, le Sénégal a un gros potentiel
Si, pour le pétrole, Woodside dispose sans doute d’une marge de manœuvre à la hausse (une deuxième phase de développement ?), que l’on ne peut cependant pas détailler aujourd’hui, le potentiel haussier pour le gaz naturel est évident et important. Comme indiqué ci-dessus, après la Phase 1 de GTA, il y aura une Phase 2 et, très probablement, une Phase 3 et, donc, une forte hausse des volumes de GNL exportés et des recettes correspondantes. Et les ressources gazières du Sénégal ne sont pas limitées à celles qui seront utilisées pour le projet GTA.
Sur le bloc Cayar Offshore Profond (COP), au sud de la zone couverte par GTA, des découvertes importantes, Yakaar et Teranga, ont en effet été réalisées. COP était détenu par un consortium composé de BP (opérateur, 60 %), de Kosmos Energy (30 %) et de Petrosen (10 %). Mais, suite à de profonds désaccords au sein de ce groupement, BP s’en est retirée à la fin 2023. COP est à présent détenu par Kosmos Energy (opérateur, 75 %) et Petrosen (25 %). Leur objectif est de faire entrer un autre partenaire en vue d’aller vers une répartition des participations qui serait d’à peu près un tiers pour chacun (34% pour Petrosen, 33 % pour Kosmos Energy et 33 % pour le futur nouveau venu). Pour COP, Petrosen a évoqué des ressources récupérables supérieures à 20 000 milliards de pieds cubes (560 milliards de mètres cubes, selon la compagnie nationale sénégalaise).