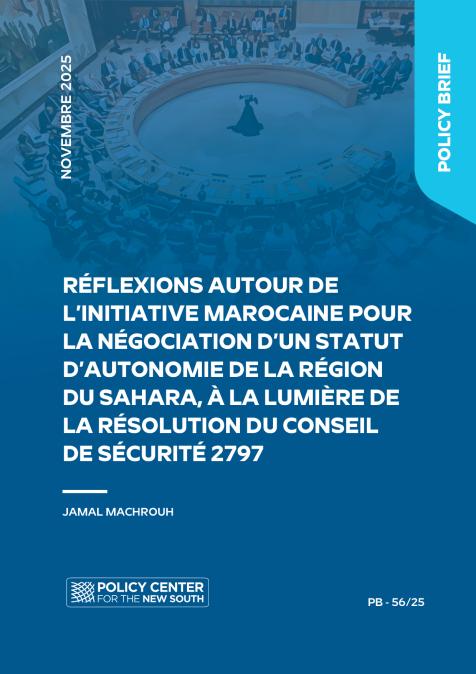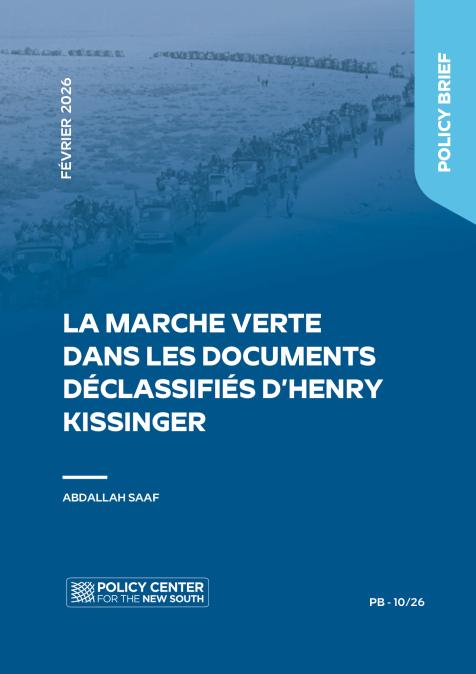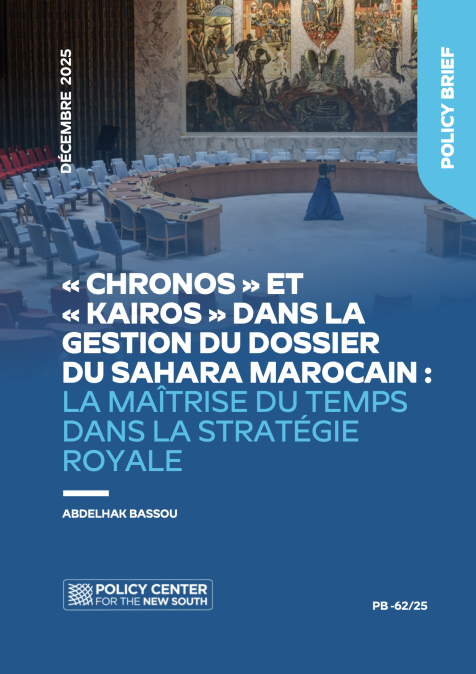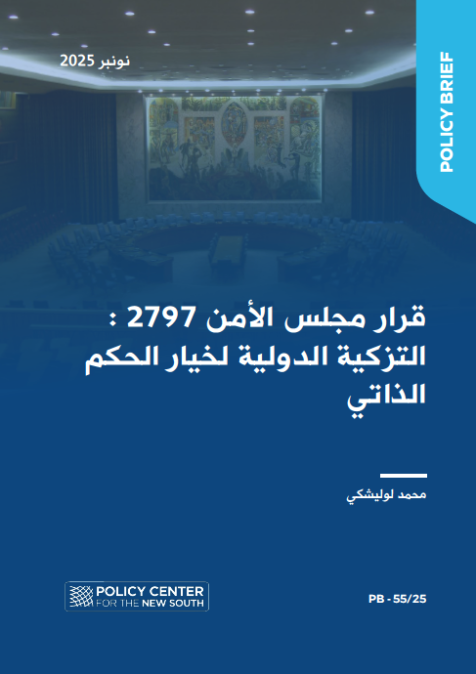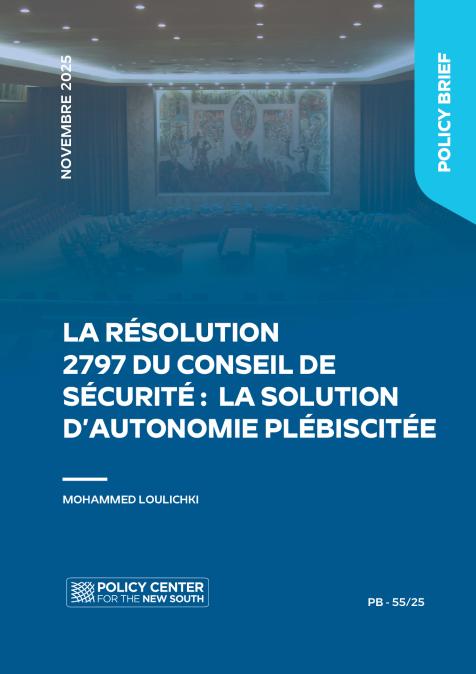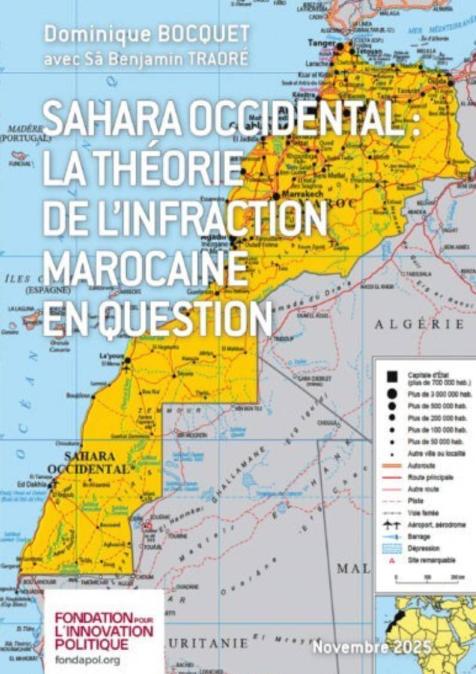Publications /
Policy Brief
L’affaire du Sahara a connu, ce vendredi 31 octobre 2025, un virage stratégique. Par sa résolution 2797, le Conseil de sécurité a clairement consacré l’Initiative marocaine d’autonomie comme étant la base exclusive de négociations pour l’arrivée à une solution définitive au conflit régional qui plombe la région depuis un demi-siècle. Ainsi que l’a souligné Sa Majesté le Roi dans son discours adressé à la nation immédiatement après l’adoption de la nouvelle résolution, « nous vivons une étape charnière et un tournant décisif dans l’histoire du Maroc moderne : Désormais, il y aura un avant et un après 31 octobre 2025 ».
La diplomatie marocaine a au moins deux bonnes raisons de satisfaction : primo, le Conseil de sécurité a entériné l’exclusivité de l’option de l’autonomie comme la base unique mais aussi la finalité des négociations. Dans le point 3 de la résolution, le Conseil de sécurité, organe suprême du système onusien, faut-il le rappeler, « demande aux parties de participer aux discussions sans conditions préalables et sur la base du plan d’autonomie proposé par le Maroc afin de parvenir à une solution politique définitive et mutuellement acceptable ». Secondo, le Conseil reconnaît le caractère régional du différend en y impliquant directement l’Algérie. Celle-ci est nommément citée et priée de s’engager dans les négociations de bonne foi.
Ce Momentum stratégique devrait constituer une raison profonde de satisfaction mais aussi inciter à formuler quelques points de vigilance. Raison de satisfaction d’abord, car après 50 ans de marche, de sacrifices et de tractations, l’option d’un dénouement final positif semble enfin se préciser. Aussi bien le Conseil de sécurité que les acteurs majeurs du système international ont adhéré à la proposition marocaine de l’autonomie de la région du Sahara sous souveraineté marocaine.
Des points de vigilance ensuite, car la résolution du Conseil de sécurité représente un commencement de la fin de l’affaire du Sahara et non pas la consécration de sa résolution définitive. Les parties au différend sont désormais appelées à négocier le statut final de la région du Sahara sur la base exclusive de la proposition marocaine de l’autonomie. C’est donc d’un changement du cadre et de logique du différend qu’il s’agit. Si le Maroc est conforté dans sa proposition d’autonomie, ce qui constitue une victoire diplomatique considérable, le royaume devrait à présent en négocier les paramètres et les contours : une véritable bataille politico-juridique se dessine, où la performance diplomatique devrait aller de pair avec l’expertise juridique et l’ingénierie rédactionnelle.
L’idée qui préside à la rédaction du présent papier procède de la volonté de participer à une indispensable réflexion autour des nouveaux enjeux qui vont structurer, à l’avenir, la question nationale. À cet effet, le papier suggère et analyse un ensemble de points susceptibles de participer au management politico-juridique des négociations autour du texte de la proposition marocaine de l’autonomie.
Ainsi considéré, un certain nombre de points, au demeurant non exhaustifs, devraient mobiliser l’attention du négociateur marocain : 1. veiller à ce que l’Initiative marocaine d’autonomie ne soit pas perçue comme une base minimale d’avantages accordés d’emblée mais comme un tout représentant un équilibre global, 2. tracer le cadre conceptuel de la notion de « véritable autonomie/ Genuine Autonomy » , 3. délimiter le sens et favoriser la portée restrictive de la « consultation référendaire » qui doit entériner le texte final sur l’autonomie du Sahara, 4. calibrer et pondérer la place et le rôle de l’Algérie dans les différentes étapes des négociations et de la mise en œuvre du texte final, 5. sauvegarder la cohérence globale du corpus juridique national en harmonisant le texte final des négociations avec le droit constitutionnel et administratif marocain, 6. saisir les changements survenus depuis 2007 pour mieux conforter la posture du négociateur marocain, et enfin, 7. établir une consubstantialité entre le principe de l’intégrité territoriale et celui de l’unité nationale.
1- Veiller à ce que le texte de l’Initiative marocaine d’autonomie ne soit pas perçu comme une base minimale d’avantages accordés d’emblée mais comme un tout représentant un équilibre global.
En effet, l’Initiative marocaine d’autonomie ne devrait pas être considérée comme un minimum de concessions garanties à l’autre partie. C’est un équilibre global susceptible certes d’être négociable, mais qui ne peut être remis en cause. Autrement dit, le texte et l’esprit de la proposition marocaine de 2007, comme celle à présenter à l’avenir, ne devraient pas être perçus comme un acquis qu’il conviendrait de renforcer par d’autres concessions marocaines durant la phase des négociations. Une technique de négociation qui viserait à remettre en cause cet équilibre serait injuste, inéquitable et exprimerait une violation caractérisée du principe de bonne foi qui doit guider toute négociation. C’est d’ailleurs pour veiller à cet équilibre global des droits et obligations des parties, que le Maroc est en droit de reconsidérer certains points de sa proposition. Il est sur ce point largement admis, aussi bien par le droit international que par la jurisprudence, que les propositions faites par une partie ne pourraient en aucun cas lui être opposables tant qu’elles ne sont pas encore actées par écrit dans un accord final qui aurait épuisé toutes les conditions de sa validité.
2- Tracer le cadre conceptuel de la notion de « véritable autonomie/Genuine Autonomy ».
Il s’agit ici d’un slippery concept qui risquerait fort d’être utilisé de manière excessive par les autres parties. Qu’est-ce,en effet, qu’une véritable autonomie ? Peut-on quantifier une telle notion et poser des lignes de démarcation nettes entre ce qui est une véritable autonomie et ce qui ne l’est pas. Ni le droit administratif ni le droit international ne tranchent de telles questions. La raison en est simple : chaque architecture d’autonomie est le fruit d’un processus singulier qui s’applique à un espace donné dans un contexte temporel particulier.
Sur ce point, il conviendrait de s’opposer à toute tentative d’importation de schémas d’autonomie géographiquement éloignés et/ou traditionnellement incompatibles avec les spécificités du droit positif marocain et de ses traditions juridiques nationales. L’idée de standards internationaux qui pourrait être soulevée lors des négociations n’implique nullement l’existence d’un corpus juridique d’autonomie universellement admis, qui serait opposable en l’espèce. Tout au plus, les « standards internationaux » pourraient avoir une valeur d’orientation mais jamais acquérir un caractère obligatoire.
3- Délimiter le sens et favoriser la portée restrictive de la « consultation référendaire » qui doit entériner le texte final sur l’autonomie du Sahara.
Certes, la proposition marocaine d’autonomie de 2007 cite à deux reprises la possibilité d’un recours au référendum. D’une part, le point 8 stipule « le statut d’autonomie, résultant des négociations, sera soumis à une consultation référendaire des populations concernées, conformément au principe de l’autodétermination et des dispositions de la Charte des Nations Unies ». Et d’autre part, le point 27 édicte que « le statut d’autonomie de la Région fera l’objet de négociations et sera soumis à une libre consultation référendaire des populations concernées. Ce référendum constitue, conformément à la légalité internationale, à la Charte des Nations Unies et aux résolutions de l’Assemblée générale et du Conseil de sécurité, le libre exercice, par ces populations, de leur droit à l’autodétermination ».
Or, la technique de consultation par voie de référendum ne devrait aucunement signifier un retour à la notion de base de celui-ci. D’abord, cela serait complétement antinomique avec le texte et l’esprit de la proposition marocaine qui, dans sa substance, se justifie par la volonté de dépasser la situation de blocage entraînée par l’obstination d’un recours au référendum. Ensuite, il faudrait souligner avec force un changement substantiel : la question qui pourrait être posée lors de la consultation référendaire ne portera nullement sur celle de l’indépendance mais uniquement sur le texte d’autonomie tel que négocié et arrêté par les parties. Plus encore, rien n’oblige les parties à penser une consultation référendaire dans la seule forme de la consultation de toute la population du Sahara ; , d’autres formes de consultation référendaire pourraient émerger des négociations, comme celle d’entériner le texte final par une ou des représentations locales.
4- Calibrer et pondérer la place et le rôle de l’Algérie dans les différentes étapes des négociations et de la mise en œuvre du texte final.
Le différend du Sahara est aujourd’hui largement qualifié comme étant de nature régionale, et l’Algérie est une partie dans ce différend. Cet état de facto et de jure est systématiquement et constamment consacré par les résolutions du Conseil de sécurité, y compris la résolution 2797. La proposition marocaine de 2007, quant à elle, le souligne parfaitement lorsqu’elle emploie méthodiquement la formule des « autres parties » et non celle de l’autre partie.
Mais il conviendrait d’apporter une nuance sur ce point. Le rôle de l’Algérie mériterait, à l’avenir, d’être pondéré en fonction des différentes étapes du processus de la résolution. Il est, en effet, possible de distinguer trois étapes essentielles dans l’Initiative marocaine de 2007 : une phase de négociations, une phase transitoire et une phase de mise en œuvre. Or, si l’Algérie devait être associée dans un premier temps en tant que partie principale, son statut devrait être réduit durant la phase transitoire et celle de la mise en œuvre. La qualité de l’Algérie devrait glisser de celle d’une partie au différend à celle d’un facilitateur, avant de cadrer naturellement avec celle d’un État tiers lié par l’obligation de non-immixtion dans les affaires intérieures des autres États.
5- Sauvegarder la cohérence globale du corpus juridique national en harmonisant le texte final des négociations avec le droit constitutionnel et administratif marocain.
Une des questions qui pourrait mobiliser l’attention des négociateurs marocains concerne le décalage entre la date de la proposition d’autonomie du Sahara initiée par le Maroc en 2007, et les années, entre autres, de l’adoption de la nouvelle constitution en 2011 et de la loi organique sur les régions en 2015. Il s’agit là d’un problème d’ordonnancement « sequencing »qui questionne les cohérences à (re)construire entre la proposition de l’autonomie du Sahara et les textes qui lui sont postérieurs. En tout état de cause, il conviendrait d’attacher une attention toute particulière à la cohérence globale du corpus juridique national, tout en veillant à ce que la proposition d’autonomie, dans sa version finale, soit compatible avec les normes du droit constitutionnel et administratif marocain, au premier rang duquel la constitution.
6- Saisir les changements survenus depuis 2007 pour mieux conforter la posture du négociateur marocain.
Dans toute négociation, les parties façonnent leurs positions et calibrent leurs concessions en fonction des réalités sur le terrain. Les clauses de départ, et encore moins les interprétations à leur donner, ne sont jamais gravées dans le marbre. Les unes et les autres sont dynamiques et évoluent en fonction des changements qu’affectent la situation des parties et l’environnement international. C’est la raison pour laquelle le négociateur marocain gagnerait à prendre en considération l’impact que pourraient avoir les rapports de force sur la table de négociations.
Or depuis 2007, année de la présentation de l’Initiative marocaine d’autonomie, la situation nationale et l’environnement international ont largement évolué, et globalement dans un sens favorable aux intérêts du Maroc. Aujourd’hui, en 2025, le royaume est beaucoup plus résilient et la communauté internationale lui est davantage acquise.
7- Établir une consubstantialité entre le principe de l’intégrité territoriale et le principe de l’unité nationale.
Une importance particulière mériterait d’être accordée au principe de l’unité nationale, lequel principe devrait constituer le corollaire indispensable du principe de l’intégrité territoriale. En effet, ériger le principe de l’unité nationale en une question fondamentale permettrait de constituer un bouclier contre toute tentative de morcellement de la nation. En effet, après leur échec à fragmenter le Maroc par la division de son territoire, les adversaires de la marocanité du Sahara pourraient être encore une fois tentés de diviser le Royaume, cette fois-ci par la segmentation de son peuple. C’est pour cela que tout schéma d’une autonomie du Sahara dans le cadre de la souveraineté marocaine devrait incorporer la préservation de son unité nationale. Ainsi, outre le territoire préservé par le principe de l’intégrité territoriale, le peuple devrait être protégé par celui de l’unité nationale. Force est de remarquer sur ce point qu’aussi bien le discours royal du vendredi 31 octobre 2025 que la constitution de 2011 citent l’unité nationale et l’intégrité territoriale dans la même ligne, ce qui témoigne de leur relation consubstantielle. Tout autant que le territoire, la nation est une et indivisible.