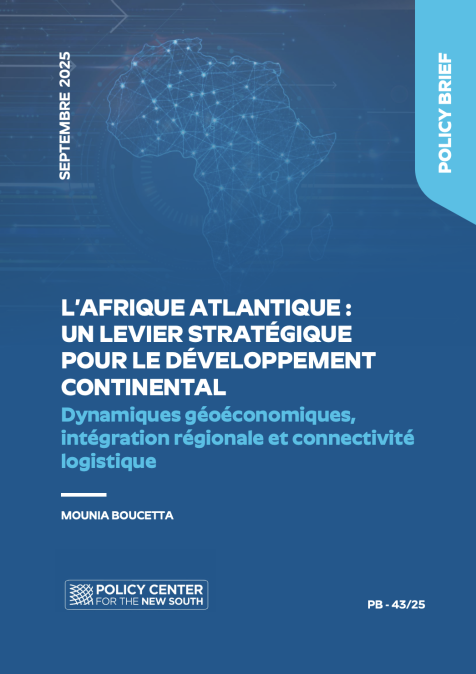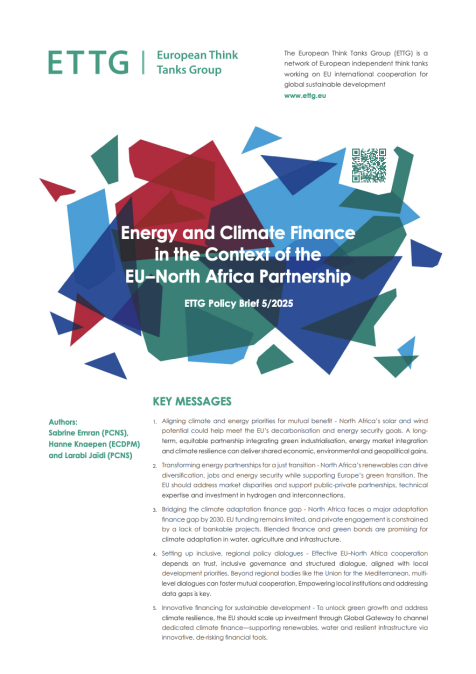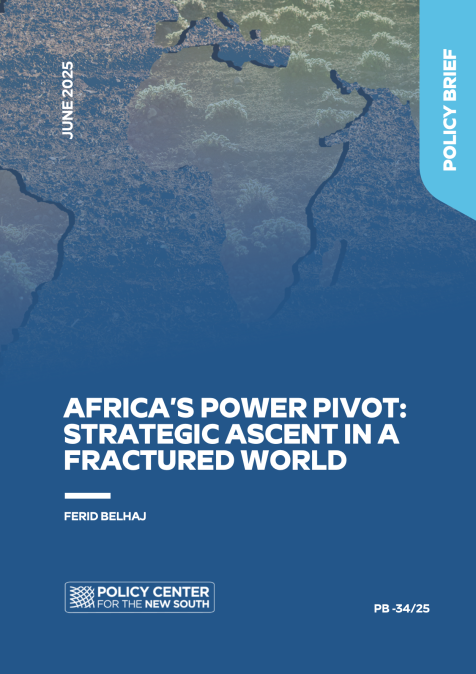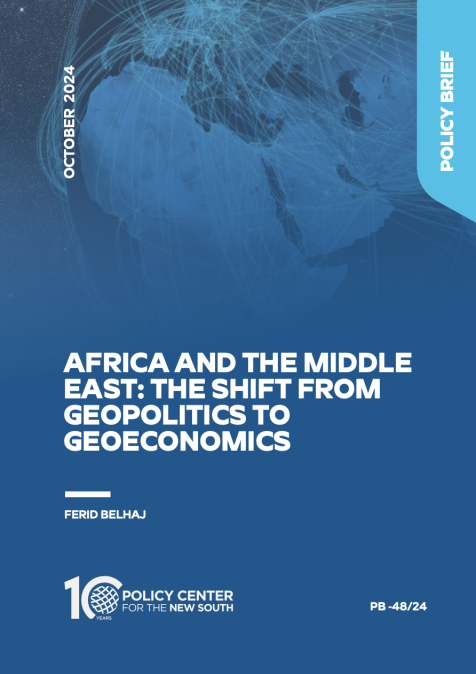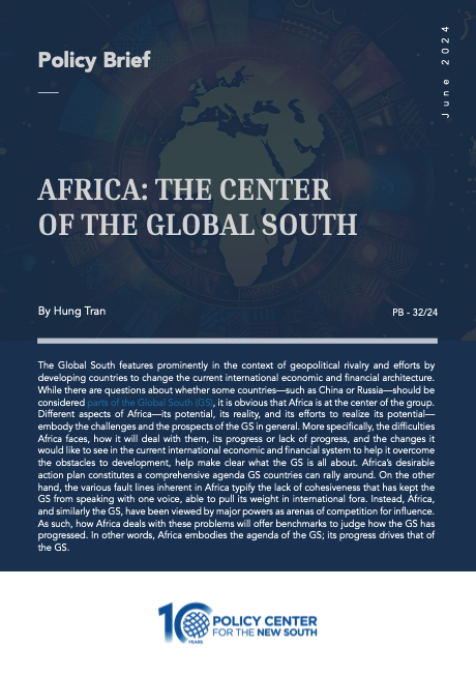Publications /
Policy Brief
Le développement de l’Afrique repose sur la mobilisation de leviers catalyseurs capables d’accélérer la dynamique de croissance avec des retombées élargies au bénéfice des populations africaines. Les transitions numérique, énergétique et démographique constituent autant de défis majeurs, mais elles présentent parallèlement de nouvelles opportunités de transformation pour le continent. Dans ce contexte, l’Afrique atlantique apparaît comme un espace stratégique et prometteur, grâce à la richesse et à la diversité de ses ressources naturelles, à son positionnement géographique et à l’intérêt croissant qu’elle suscite auprès de divers acteurs internationaux. L’enjeu central est de déterminer comment cet espace peut jouer un rôle de moteur de transformation en tirant parti de ces transitions et en tenant compte des dynamiques économiques au sein du bassin atlantique, des stratégies d’intégration régionale des pays riverains, ainsi que des enjeux sécuritaires et géoéconomiques.
Introduction
L’Afrique progresse, mais ses avancées demeurent limitées, avec un rythme insuffisant pour l’atteinte des Objectifs de développement durable (ODD) à l’horizon 2030, ou même pour concrétiser l’« Agenda 2063 : l’Afrique que nous voulons » , adopté par l’Union africaine en 2015. Cette progression, très inégale et peu soutenue, s’explique notamment par des vulnérabilités persistantes face à des crises multiples, internes comme externes. Ces fragilités structurelles se traduisent par des indicateurs de développement encore alarmants dans plusieurs régions, avec un risque de détérioration suite au recul de l’aide internationale, en particulier depuis les coupes budgétaires européennes engagées en 2021 et les décisions de l’administration Trump en 2025. En effet, dans un contexte où l’exposition au risque reste élevée pour de nombreux pays africains, la baisse de cette aide réduit leur capacité à mobiliser les financements nécessaires aux projets de développement.
Le contexte géoéconomique mondial, associé aux défis propres à l’Afrique, appelle à repenser en profondeur les leviers de développement mobilisés jusqu’à présent, afin d’identifier ceux qui sont réellement en mesure de soutenir l’essor du continent. Cette reconfiguration stratégique exige des choix éclairés en matière de priorités, de solutions, de technologies ou de partenariats. L’Afrique a besoin de leviers catalyseurs et transformateurs susceptibles d'accélérer sa marche vers le progrès de manière durable, de soutenir le déploiement des réformes structurelles, et de générer des effets multiplicateurs bénéficiant aux différentes régions et à l’ensemble des couches sociales. Les spécificités propres au continent devraient guider l’identification de ces leviers qui seraient les plus à même de produire les effets recherchés, sans forcément emprunter des chemins existants ou préétablis.
Sans aucun doute, l’intégration économique aussi bien régionale que continentale demeure un levier essentiel, dans la mesure où les défis actuels ne peuvent être relevés par un pays agissant isolément et que certains investissements ne sont viables qu’à une échelle régionale. De nouveaux modèles de coopération sont à envisager pour éviter les difficultés vécues par des communautés économiques régionales (CER) africaines et remédier aux insuffisances en matière de mobilisation de ressources et de gouvernance. Ces communautés, bien qu’ayant apporté certaines avancées, ont également montré des limites, qu’il s’agisse de blocages institutionnels ou d’un faible niveau de coopération économique. Dans le même sens, la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF) présente un modèle d’intégration économique très prometteur. Sa réussite dépendra non seulement de sa capacité à stimuler les échanges intra-africains, mais surtout de sa contribution à la construction de chaînes de valeur régionales compétitives et à l’émergence de nouvelles opportunités économiques à l’échelle continentale. De la même manière, les espaces maritimes peuvent constituer de puissants vecteurs d’intégration économique, notamment pour les pays riverains. En renforçant leur coopération, ces derniers peuvent développer des hubs logistiques performants et améliorer leur insertion dans les chaînes de valeur mondiales.
Par ailleurs, le développement du continent nécessite des transformations profondes et durables. Accroître les investissements dans des secteurs essentiels et stratégiques, tels que l’énergie, l’eau, les systèmes alimentaires, la santé, l’industrie ou encore la logistique, constitue en effet une condition clé pour réaliser de nombreux ODD. Toutefois, comment y parvenir dans un contexte où de nombreux pays africains affichent déjà des niveaux d’endettement proches, voire supérieurs, aux seuils critiques, où l’accès aux financements concessionnels se rétrécit, où les banques multilatérales de développement soulignent des fragilités structurelles en matière de gouvernance, et où l’attractivité du continent pour les investissements directs étrangers demeure limitée, ne représentant que 2 à 3 % des flux mondiaux ?
Accélérer le développement en Afrique passe par un déploiement stratégique des investissements. Les projets recherchés devraient s’inscrire dans une vision à long terme, alignée sur l’ambition d’une intégration économique renforcée du continent. L’innovation, qu’elle intervienne au stade de la conception, de la structuration financière ou des modalités de mise en œuvre, constitue un levier essentiel, capable de générer des externalités positives durables et de mobiliser des investissements privés. Il peut s’agir, par exemple, de grands projets d’infrastructures transnationales, conçus pour stimuler les synergies logistiques, énergétiques ou numériques entre les pays africains. D’autres formes d’initiatives peuvent porter sur la création de clusters industriels ou technologiques, favorisant la transformation locale des ressources naturelles et leur insertion dans les chaînes de valeur régionales et mondiales.
Dans cette perspective, l’axe atlantique africain représente un vecteur d’intégration géographique encore largement sous-exploité, mais porteur d’un fort potentiel de transformation. Il pourrait devenir un modèle réussi d’intégration régionale, en s’appuyant sur des atouts géostratégiques de premier plan : proximité des marchés européens et américains dynamiques, ancrage dans les grandes routes maritimes mondiales et richesse en ressources naturelles diversifiées. Transformer ces avantages en leviers concrets de développement et d’intégration économique, tant à l’échelle régionale que continentale, requiert une volonté politique affirmée, des investissements ciblés et une gouvernance coordonnée entre pays riverains.
Cette analyse explore le potentiel économique de l’Afrique atlantique et le rôle qu’il peut jouer dans le développement du continent, en tenant compte des dynamiques économiques et des approches d’intégration régionales adoptées par les pays riverains du bassin atlantique, de leur environnement logistique, des enjeux sécuritaires influençant les échanges commerciaux et les investissements, ainsi que des nouvelles recompositions géoéconomiques.
1- L’importance géoéconomique de l’espace nord-transatlantique
Le bassin atlantique se distingue par des dynamiques multiples et contrastées, marquées par de fortes disparités entre ses rives nord et sud. Il reste pourtant l’un des espaces maritimes les plus stratégiques du globe, non seulement en raison de l’intensité de ses flux commerciaux, énergétiques et logistiques, mais aussi parce qu’il apparaît, à ce jour, relativement épargné par certains risques qui fragilisent d’autres régions maritimes. Tandis que les tensions militaires, les blocages, les accidents navals, les restrictions de navigation ou encore les attaques par drones et missiles se multiplient ailleurs, l’océan atlantique conserve, pour l’instant, une forme de stabilité précieuse, à l’exception du golfe de Guinée, qui connaît des épisodes de piraterie et de criminalité maritime à risque relativement élevé. Il convient de rappeler que si l’Atlantique Nord fut au cœur des rivalités de la Guerre froide, l’Atlantique Sud pour sa part a longtemps été envisagé comme un espace à préserver. En 1986, l’ONU a proclamé la « Zone de paix et de coopération de l’Atlantique Sud » (ZPCAS), réunissant pays africains et sud-américains, avec l’objectif d’éloigner cet espace des conflits, des bases militaires étrangères et des armes nucléaires.
Les réalités géoéconomiques et sécuritaires actuelles de ce bassin révèlent trois zones avec des caractéristiques distinctes. L’Atlantique Nord reliant les nations d’Europe occidentale (du littoral atlantique européen) aux États-Unis et au Canada. Il s’agit du cœur historique de la coopération transatlantique caractérisée par un niveau élevé de coopération institutionnalisée, notamment à travers l’Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN). Cet espace constitue l’axe logistique principal pour tout renfort américain en Europe en cas de crise, où patrouillent les sous-marins nucléaires lanceurs d’engins (SNLE), doté d’une flotte importante de navires et porte-avions pour renforcer la sécurité maritime. Malgré les capacités militaires et technologiques de l’OTAN, cette région connait l’émergence de menaces d’attaques et de sabotages des câbles sous-marins, notamment ceux reliés à la mer Baltique, l’une des régions les plus exposées ces dernières années. Par ailleurs, cette zone est aussi marquée par le trafic de drogue en provenance d’Amérique latine et à destination de l’Europe via l’Atlantique Nord, ainsi que par les migrations irrégulières empruntant la route maritime des Caraïbes vers les États-Unis ou encore celle reliant l’Afrique de l’Ouest aux îles Canaries.
Sur le plan économique, le bassin de l’Atlantique Nord est l’une des régions économiques les plus dynamiques même s’il ne représente que près de 14% du trafic mondial de conteneurs, derrière les flux transpacifiques et Asie-Europe. Il reste toutefois un espace stratégique et un réservoir énergétique important, en raison des flux pétroliers et gaziers en provenance des États-Unis, devenus le principal producteur mondial dans ce secteur et le premier fournisseur de gaz naturel liquéfié (GNL) de l’Europe depuis le début du conflit russo-ukrainien.
Cette région est également le théâtre du développement de projets transnationaux d’envergure, à l’image du corridor de transport Atlantique Européen « Atlantic European Transport Corridor (ETC) »qui est actuellement en cours de déploiement. Il vise à relier, par voies ferroviaire, routière, fluviale et maritime, plusieurs pays européens, dont le Portugal, l’Espagne, la France, l’Allemagne et l’Irlande. Il desservira à terme 25 ports, 27 terminaux rail-route et 59 nœuds urbains. Parallèlement, d’autres initiatives d’interconnexion énergétique entre l’Amérique du Nord et l’Europe de l’Ouest sont à l’étude, explorant les possibilités de renforcer la sécurité énergétique transatlantique nord. Il convient également de souligner le développement rapide des infrastructures numériques, en particulier le déploiement de réseaux de fibre optique sous-marins, principalement portés par des opérateurs privés tels que Google, Meta et Microsoft.
En 2023, les États-Unis (EU) ont lancé le « Partenariat pour la coopération atlantique » (PAC) réunissant 32 pays d’Europe, d’Afrique et des Amériques pour dépasser le traditionnel axe transatlantique EU-Europe et intégrer davantage l’Afrique et l’Amérique latine dans leur stratégie globale. Ce cadre de coopération devait traiter un large éventail de questions, allant du développement économique à la protection de l’environnement, en passant par la science et la technologie, notamment via l’économie océanique durable, la gestion des ressources et la lutte contre la pêche illégale ou les trafics. Selon un communiqué de la Maison Blanche en date du 23 septembre 2024, depuis le lancement du PAC, 42 pays en sont devenus membres, représentant 75% du littoral atlantique. Avec l’arrivée de l’administration Trump, l’avenir de ce partenariat apparaît désormais incertain, dans un contexte géopolitique complexe marqué par une approche américaine plus transactionnelle et centrée sur ses intérêts nationaux. Le contrôle des zones maritimes clés, des infrastructures économiques stratégiques et des ressources naturelles critiques figurent néanmoins parmi les priorités affichées.
2- L’espace atlantique latin : intégration régionale, coopération et sécurité
Dans la partie sud du bassin atlantique, deux grands ensembles géographiques peuvent être distingués : d’une part, la façade atlantique de l’Amérique latine et des Caraïbes et, d’autre part, la façade atlantique africaine. La zone latino-américaine comprend les pays d’Amérique latine et des Caraïbes ayant un littoral atlantique, en particulier les pays riverains du golfe du Mexique, les États d’Amérique centrale orientale, les îles des Caraïbes, ainsi que les pays de la façade atlantique de l’Amérique du Sud, s’étendant du Venezuela jusqu’à l’Argentine. Cet espace se caractérise par une diversité de dynamiques régionales, marquées par des niveaux variables de coopération politique et économique. Il comprend à la fois des puissances régionales, comme le Brésil classé entre neuvième et dixième économie mondiale ces dernières années, et des États insulaires des Caraïbes, relativement plus vulnérables économiquement, mais stratégiquement bien positionnés. Selon la Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement (CNUCED), le poids des flux conteneurisés en Amérique latine sont relativement faibles, représentant près de 7% des flux mondiaux totaux et portés en grande partie par la façade atlantique à travers ses principaux hubs de transbordement (Colón, Kingston, Caucedo, Montevideo) et ses grands ports d’exportation (Santos, Buenos Aires).
Le MERCOSUR (Marché commun du Sud) constitue un modèle d’intégration économique et commerciale partiellement achevé, réunissant le Brésil, l’Argentine, l’Uruguay et le Paraguay. Dans une logique similaire, les pays d’Amérique centrale ont mis en place le Système d’intégration centraméricain (SICA), regroupant notamment le Guatemala, le Nicaragua, le Honduras et le Costa Rica, fondé sur une coopération économique et politique, bien que parfois fragilisée par l’instabilité institutionnelle et les tensions internes. De leur côté, les États des Caraïbes ont également constitué des organisations régionales, telles que la CARICOM (Communauté caribéenne), visant une intégration économique régionale, mais dont le dynamisme reste freiné par des contraintes structurelles à cause du faible poids économique de l’ensemble et à l’application de mesures protectionnistes.
Malgré l’existence de plusieurs cadres de coopération économique, les flux maritimes de la région restent majoritairement orientés vers l’Amérique du Nord, l’Asie et l’Europe. Il est à noter que les échanges interrégionaux en Amérique latine demeurent limités, ne dépassant pas 16 % de ces flux. Au cours des dernières décennies, la Chine s’est imposée comme un acteur économique central, en important massivement des ressources naturelles, particulièrement en provenance de l’Atlantique sud-américain (minerai de fer, cuivre, soja, pétrole) et en investissant dans les infrastructures logistiques et énergétiques de la région. À titre d’exemple, la Chine détient totalement ou partiellement des centaines de centrales électriques au Brésil, représentant près de 10 % de la capacité nationale de production d’électricité. Par ailleurs, sa plus grande installation spatiale située hors du territoire chinois se trouve en Argentine. Plus récemment, la Chine a recentré ses investissements vers des secteurs stratégiques ciblés, tels que la mobilité électrique, les énergies renouvelables, les télécommunications et le numérique. Elle est ainsi devenue le premier partenaire commercial de l’Amérique du Sud et le deuxième après les EU à l’échelle de l’Amérique latine.
La façade atlantique de l’Amérique latine demeure historiquement et économiquement prépondérante au sein du continent, concentrant les principaux pôles industriels, démographiques et logistiques, notamment au Brésil, en Argentine et en Uruguay. Les pays latino-américains, y compris ceux riverains de l’Atlantique, cherchent à se positionner comme des plateformes stratégiques de connexion entre l’Atlantique et le Pacifique, ainsi qu’entre les marchés du Nord et du Sud. Dans ce cadre, le développement de corridors logistiques constitue depuis longtemps un axe central des politiques économiques de ces pays. Néanmoins, les infrastructures de la région nécessitent encore des investissements conséquents afin de renforcer leur compétitivité et leur performance à l’échelle mondiale.
Parmi les infrastructures logistiques les plus importantes figure le corridor fluvial de l’Hidrovía Paraná-Paraguay, long de plus de 3 400 km, traversant cinq pays (Brésil, Argentine, Paraguay, Bolivie et Uruguay) pour se connecter à l’océan Atlantique. Ce corridor permet le désenclavement du Paraguay et de la Bolivie. Il est opérationnel, mais fait l’objet de travaux réguliers de dragage et de maintenance afin de lever les contraintes de navigation à certains endroits. Il y a lieu de noter également l’existence de plusieurs corridors logistiques terrestres, connectant, par voies ferroviaires ou routières, des hubs ou zones multimodales. Toutefois, ces couloirs sont parfois perçus non pas comme des instruments de complémentarité entre économies locales, mais plutôt comme des vecteurs de mise en concurrence. Ce qui parfois pousse certains pays à rechercher des bénéfices strictement nationaux, au détriment des dynamiques d’intégration régionale.
Le corridor atlantique sud (Corredor Bioceánico Vial) constitue un mégaprojet routier de plus de 2 400 km, destiné à relier Campo Grande, au Brésil, aux ports du nord du Chili (Antofagasta, Iquique et Mejillones), en traversant le Paraguay et l’Argentine. Actuellement en cours de développement, son inauguration est prévue à l’horizon 2026. Ce projet vise à réduire significativement les coûts logistiques et à capter jusqu’à 40 % du trafic de marchandises actuellement acheminé via le Canal de Panama. Parallèlement, d’autres initiatives sont en cours de lancement afin de renforcer les interconnexions entre les façades atlantique et pacifique du continent, à travers de nouveaux corridors bi-océaniques. C’est le cas notamment d’une ligne ferroviaire de près de 4 000 km, destinée à relier le port de Santos, au Brésil, à celui d’Ilo, au Pérou. Ces liaisons devraient non seulement faciliter les échanges commerciaux avec l’Asie, mais aussi contribuer au développement du commerce transpacifique en diversifiant les routes logistiques continentales.
Un autre domaine susceptible de renforcer l’intégration régionale en Amérique latine est celui de la transition énergétique verte. L’un des développements les plus prometteurs en la matière est associé à l’hydrogène vert ou à faible teneur en carbone. En effet, le portefeuille régional compterait près de 167 projets à différents stades de conception et de mise en œuvre. Selon les estimations de l’Organisation latino-américaine de l’énergie (Olade), ces projets nécessiteraient des investissements de l’ordre de 300 milliards USD à l’horizon 2050. De son côté, H2 Chile (Association chilienne de l’hydrogène), une organisation à but non lucratif qui rassemble les principaux acteurs de l’industrie de l’hydrogène au Chili, a annoncé le développement de 75 projets au Chili dans ce secteur, dont 14 sont déjà opérationnels et 70 % concernent le secteur de la mobilité. Parallèlement, des initiatives similaires sont en cours d’étude ou de lancement au Brésil et en Argentine.
L’émergence d’un tel écosystème implique la mise en place d’infrastructures transfrontalières, notamment des pipelines pour le transport et la distribution de l’hydrogène, ainsi que des réseaux électriques alimentés par des énergies renouvelables. La région devrait pouvoir attirer davantage d’investissements étrangers et créer des conditions de financement plus favorables pour concrétiser son programme. Quelques obstacles restent toutefois posés, notamment la complexité des infrastructures à déployer, la nécessité d’un cadre réglementaire stable et adapté, ainsi que la gestion des coûts de financement et des risques liés aux projets innovants.
Enfin, malgré la volonté politique affichée par les différents groupements d’Amérique latine en faveur d’un renforcement de l’intégration économique régionale, de nombreux obstacles persistent. Parmi eux, on peut citer l’insuffisance de plateformes logistiques performantes, les contraintes liées à la géographie, les barrières tarifaires, ainsi que les fortes asymétries économiques entre pays partenaires. À ces difficultés structurelles s’ajoute le trafic illicite de stupéfiants, véritable fléau qui fragilise les économies nationales. Ce phénomène entraîne une hausse des coûts et des délais logistiques, tout en compliquant et en renchérissant les paiements transfrontaliers. Profondément ancré dans l’espace atlantique latino-américain, ce trafic permet à une part significative de la cocaïne produite dans la région andine de transiter par les routes maritimes de la mer des Caraïbes et de l’Atlantique Sud. Ce flux passe souvent par l’Afrique de l’Ouest avant de parvenir en Europe. Les capacités de surveillance maritime demeurent cependant très inégales d’un pays à l’autre: si le Brésil et l’Argentine disposent de forces navales relativement développées, de nombreux États caribéens et d’Amérique centrale restent fortement démunis face au narcotrafic maritime, en raison de moyens matériels et d’équipements insuffisants.
3- Faire de l’Afrique Atlantique un moteur du développement continental
Les enjeux du développement durable du continent mettent en évidence l’urgence pour les pays africains d’agir collectivement, mais autrement. En effet, tous les indicateurs convergent vers un constat préoccupant : les efforts engagés jusqu’à présent restent largement en deçà des objectifs visés, qu’il s’agisse de croissance économique inclusive, de justice sociale ou de durabilité environnementale. Dans ce contexte déjà très complexe, trois transitions majeures –numérique, démographique et énergétique- vont davantage bouleverser les tendances mondiales aussi bien pour les pays développés que moins avancés. Selon les approches adoptées, elles pourraient soit accentuer les vulnérabilités actuelles du continent, soit au contraire constituer des leviers d’accélération décisifs pour son développement.
La transition numérique, marquée par l’émergence de technologies disruptives telles que l’Internet des objets (IoT), l’intelligence artificielle, ou la blockchain, redessine les rapports de production, de gouvernance et de communication. Cette mutation appelle une adaptation rapide des politiques publiques, des systèmes éducatifs ou des écosystèmes numériques de production et d’exploitation des données, sous peine d’accentuer les fractures numériques et sociales. De même, la transition démographique africaine constitue à la fois un défi et une opportunité. Si elle est bien gérée, cette dynamique pourrait représenter un levier formidable de croissance endogène, d’innovation et de renouvellement des talons, vu le poids de la population jeune. À l’inverse, sans politiques adéquates, elle risque d’alimenter le chômage et les migrations non organisées. Pour ce qui concerne la transition énergétique, celle-ci remet en question les équilibres géopolitiques traditionnels, en redistribuant les cartes du pouvoir autour des nouvelles sources d’énergie, des matières premières critiques et des technologies vertes. Les pays capables de maîtriser ces nouvelles chaînes de valeur pourraient accroître leur capacité d’influence et de résilience sur la scène internationale.
Par ailleurs, les enjeux de souveraineté occupent une place de plus en plus centrale. Ils ne se limitent plus aux domaines traditionnels tels que la sécurité alimentaire ou sanitaire, mais s’étendent désormais à des secteurs hautement stratégiques : technologies numériques, données, énergie, ou encore minerais critiques. Cette souveraineté, recherchée à plusieurs niveaux, nécessite une redéfinition des modèles d’action et de nouveaux cadres de coopération entre les pays africains et plus globalement au niveau international. En effet, de nombreux projets structurants, notamment dans les domaines de la transition énergétique, des transports et de la logistique, ne peuvent aboutir sans une coopération étroite entre les États africains, notamment voisins. L’interconnexion des réseaux et des infrastructures, ainsi que le développement de projets transfrontaliers créent les conditions favorables pour garantir la viabilité économique des investissements, ainsi que leur durabilité.
Plusieurs régions africaines disposent de ressources importantes, énergétiques, halieutiques, minérales ou agricoles ; cependant, leur valorisation reste très limitée, les exportations se faisant généralement à l’état brut. Le déficit important en infrastructures, aggravé par le faible niveau d’interconnexion régionale nécessaire à l’optimisation des coûts logistiques, ainsi que l’accès restreint à une électricité compétitive, freinent l’attractivité des investissements dans des projets industriels de transformation. C’est notamment le cas de l’Afrique Atlantique, riche en ressources naturelles, mais marquée par de fortes disparités en matière de développement et d’accès à l’électricité : ainsi, si le taux d’électrification au Maroc ou au Cabo Verde dépasse 90 %, il est à peine de 30 % au Liberia et en Sierra Leone.
L’investissement dans des projets transfrontaliers et interconnectés pourrait pourtant produire des effets catalyseurs significatifs, tant pour la région que pour l’ensemble du continent. La façade atlantique africaine bénéficie en effet d’un positionnement géostratégique favorable ; située au cœur d’un bassin en profonde mutation, elle est portée à la fois par l’essor des dynamiques transatlantiques nord et par les transformations en cours dans l’Atlantique Sud. Ces évolutions ouvrent des perspectives prometteuses en faveur d’une croissance plus soutenue et plus intégrée dans les années à venir. La Banque mondiale estime d’ailleurs que l'économie de l’espace atlantique génère déjà près de 1,5 billion USD par an de l'économie mondiale, un volume appelé à doubler d’ici 2030.
D’autre part, les 23 pays africains bordant l’Atlantique, allant du Maroc jusqu’à l’Afrique du Sud, concentrent à eux seuls environ 55 % du PIB du continent et 46 % de sa population. Toute initiative de transformation menée dans cet espace aurait donc des effets démultiplicateurs : elle renforcerait la dynamique régionale tout en produisant des retombées positives à l’échelle du continent africain.
En 2022, le Maroc a lancé le Processus des États africains de l’Atlantique (PEAA), destiné à instaurer un espace de concertation et de coopération entre les pays de cette région, afin de renforcer la sécurité, la stabilité et la prospérité. Depuis, des réunions ministérielles annuelles se tiennent régulièrement, la plus récente ayant eu lieu à Praia en mai 2025.Dans le même cadre, l’initiative de l’Afrique Atlantique, lancée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI lors du discours prononcé à l’occasion du 48ème anniversaire de la Marche Verte en novembre 2023, se distingue par la pertinence de sa portée stratégique. Cette initiative tout en mettant l’accent sur l’importance des liens et des actions de coopération entre les 23 États africains de la façade atlantique vise le désenclavement des pays du Sahel en mettant à niveau leurs infrastructures et en les connectant aux réseaux de transport et de communication implantés dans leur environnement régional, afin de faciliter leur accès à l’Atlantique.
L’un des projets qui illustre parfaitement l’esprit de cette initiative est le gazoduc Nigeria–Maroc, également appelé Gazoduc Afrique-Atlantique, lancé en 2016 par Sa Majesté le Roi Mohammed VI et le Président Muhammadu Buhari. Ce projet d’envergure prévoit de relier le Nigeria au Maroc en longeant la côte atlantique et ses 13 pays d’Afrique de l’Ouest, sur une longueur estimée à environ 6 800 kilomètres, avec la possibilité d’alimenter en gaz des pays sahéliens enclavés. À terme, ce gazoduc devrait permettre d’acheminer près de 30 milliards de mètres cubes de gaz naturel par an, dont une part importante pourrait être exportée vers l’Europe.
En connectant à la fois des pays producteurs et des pays exportateurs de gaz, ce projet fédérateur ambitionne de soutenir le développement économique et social de la région. Il vise à améliorer l’accès à l’énergie pour plusieurs pays importateurs, ce qui pourrait stimuler leur activité économique et contribuer à l’amélioration des conditions sociales de leur population. Parallèlement, le renforcement des infrastructures gazières permettra à plusieurs pays d’accroître leurs capacités d’exportation tout en réduisant leurs coûts logistiques. Actuellement à un stade avancé d’études, le projet sera mis en œuvre par phases, dont la première est prévue à l’horizon 2029.
Le Gazoduc Afrique-Atlantique est un exemple de modèle d’intégration énergétique qui peut être déployé dans d’autres secteurs afin d’impulser une véritable transition énergétique dans la région. En s’appuyant sur ses importantes réserves gazières et sur l’abondance de ressources naturelles, notamment les ressources hydriques et les vastes superficies côtières propices au solaire, à l’éolien et à la production d’hydrogène vert ou bas carbone, l’Afrique Atlantique est bien positionnée pour accueillir des corridors énergétiques diversifiés (gaziers, énergies renouvelables et à faible intensité carbone). Ces corridors favoriseraient l’émergence d’un réseau intégré de hubs énergétiques, interconnectés par des infrastructures modernes telles que gazoducs, réseaux électriques et installations portuaires. De tels hubs contribueraient non seulement à sécuriser l’approvisionnement régional en énergies propres et bas carbone, mais aussi à répondre à une partie de la demande européenne.
Ce schéma s’inscrit pleinement dans les nouvelles transformations du paysage portuaire mondial. La généralisation de la conteneurisation a conduit à une spécialisation accrue des terminaux et à une extension progressive des infrastructures portuaires. Dans ce contexte, de vastes zones logistiques intégrées émergent autour des ports, renforçant les synergies entre les nœuds portuaires et les grands corridors continentaux. Parallèlement, la transition énergétique du secteur maritime impose de nouveaux impératifs : la création de hubs d’approvisionnement en carburants synthétiques (e-fuels) et l’électrification verte des quais. Ces évolutions visent à répondre à l’objectif fixé par l’Organisation maritime internationale (OMI), en l’occurrence réduire de 50 % les émissions du transport maritime d’ici 2050, par rapport aux niveaux de 2008.
Ces dynamiques énergétiques et logistiques ouvrent des perspectives intéressantes pour le repositionnement de l’Afrique atlantique, fondé sur des transformations structurelles et des investissements ciblés. Le renforcement des interconnexions logistiques, réseaux électriques et câbles numériques y sont déterminants, de même que l’accompagnement à l’émergence de nouvelles filières industrielles, logistiques et de services afin de tirer pleinement parti de ces évolutions. L’objectif étant de développer des plateformes régionales compétitives, pleinement intégrées aux chaînes de valeur mondiales, dans le cadre d’une vision commune portée par les pays africains concernés et traduite en mécanismes efficaces de coopération et de gouvernance.
4- L’Afrique Atlantique et les nouvelles recompositions géoéconomiques
La rive africaine du bassin atlantique, à l’instar de la façade latino-américaine, suscite un intérêt croissant et devient un espace de recomposition des influences économiques. Cette dynamique s’accompagne par la montée en puissance de nouveaux acteurs non-africains, au premier rang desquels figurent la Chine, les Émirats Arabes Unis, la Russie et la Turquie. Dans un contexte de concurrence géoéconomique accrue, les initiatives portées par ces pays se concentrent principalement sur le commerce, les ressources naturelles et les infrastructures.
Malgré l’intensification de ces nouvelles présences, les pays européens et les EU restent des partenaires économiques importants pour les États africains riverains de l’Atlantique. Les échanges commerciaux restent largement dominés par l’exportation des hydrocarbures (pétrole et gaz), des minerais (fer, bauxite, or, cuivre,…), des produits agricoles, ainsi que par quelques produits manufacturés, notamment en provenance de l’Afrique du Sud, du Maroc et du Nigeria. Parallèlement, la Chine étend progressivement son empreinte, s’imposant comme premier partenaire commercial d’économies africaines importantes de l’Atlantique, en particulier le Nigeria et l’Afrique du Sud.
Tenant compte de ces nouvelles tendances, l’Union Européenne cherche à préserver ses relations historiques, en lançant sa stratégie “Globale Gateway” couvrant la période 2021-2027, avec une enveloppe de 150 milliards EUR d’investissement, réservée à l’Afrique pour financer des projets dans l’énergie verte, le numérique, les infrastructures de transport, la santé et l’éducation. À mi-parcours, 26 projets sont identifiés, dont une grande partie destinée au climat et à l’énergie. Ces projets sont également orientés pour ouvrir de nouvelles opportunités au secteur privé européen en Afrique. De leur côté, les EU ont réorienté leur mode d’intervention en Afrique. En 2025, les initiatives américaines dirigées par le Président Trump ont davantage privilégié un partenariat commercial transactionnel, autour des ressources naturelles et des investissements stratégiques, tout en réduisant l’aide conventionnelle au développement et en adoptant des mesures protectionnistes pour protéger l’industrie américaine.
Dans ce contexte, les ports africains jouent un rôle clé dans la dynamisation des échanges commerciaux. Tanger Med se présente comme l’un des ports les plus avancés et les plus importants du continent en matière de trafic de conteneurs, avec une capacité de 9 millions d’EVP (équivalents vingt pieds). Classé 17ème au niveau mondial en 2024, selon Alphaliner, il a traité 10,24 millions d’EVP cette année-là, enregistrant une croissance de plus de 18,8 % par rapport à l’année précédente. Au niveau de la sous-région ouest-africaine, les principaux ports sont Lagos (Nigeria), Abidjan (Côte d’Ivoire), Dakar (Sénégal) et Douala (Cameroun), représentant environ 30 % du trafic portuaire régional. Par ailleurs, Durban (Afrique du Sud) figure parmi les ports les plus fréquentés du continent, en raison de sa position stratégique sur une route commerciale mondiale majeure. Bien que situé sur l’océan Indien, Durban est également connecté aux flux commerciaux de l’Atlantique via la route maritime du Cap de Bonne-Espérance, ce qui renforce son rôle dans les échanges interocéaniques. De nouveaux projets portuaires sont en cours de développement, tel que le port de Dakhla Atlantique au Maroc, le port de Ndayane au Sénégal et le port de Barra do Dande en Angola qui devraient renforcer les capacités logistiques de la région et augmenter le volume des flux commerciaux.
Ces ports revêtent un intérêt central, puisqu'ils s’intègrent à la fois en amont et en aval des corridors logistiques. De ce fait, ils suscitent la convoitise de plusieurs pays, porteurs d’intérêts à la fois commerciaux, politiques et militaires. Depuis le lancement par la Chine de l’initiative des Nouvelles Routes de la Soie (One Belt, One Road) en 2013, ses priorités en Afrique se sont focalisées sur ces installations, en maintenant une présence militaire et logistique au niveau de certaines bases navales. La Chine s’impose comme le premier bailleur étranger, le nombre de ses projets portuaires en Afrique dépasse ceux réalisés en Amérique latine ou en Asie. Elle est ainsi impliquée dans plus d’une trentaine de ports au niveau de la façade atlantique. Le rôle des entités chinoises varie selon les projets : constructeur, gestionnaire, bailleur ou simple financier. Seuls cinq ports ont été réalisés sous forme d’investissements directs chinois, principalement en Guinée, au Nigeria, en Côte d’Ivoire, au Cameroun et en Sierra Leone. La Chine cherche à sécuriser ses approvisionnements en hydrocarbures et en minerais, tout en consolidant son contrôle des chaînes logistiques et des routes maritimes. Après le repli de ses engagements financiers en 2017, causé par le ralentissement de son économie et par l’augmentation du niveau d’endettement de plusieurs pays africains, Pékin a relancé ses interventions sur le continent à partir de 2023. Cette reprise se distingue par une amélioration de la qualité des investissements, une diversification vers de nouveaux secteurs tels que le numérique, les fintechs, l’agritech ou encore le commerce en ligne, ainsi qu’une implication plus importante du secteur privé chinois. Elle se traduit également par un recentrage sur des projets de moindre envergure mais mieux ciblés, à l’impact environnemental positif, favorisant la diffusion de quelques solutions technologiques vertes développées en Chine.
Les Émirats Arabes Unis (EAU) ont également augmenté leurs investissements en Afrique ces dernières années, profitant de la période où la Chine a commencé à réduire ses engagements au niveau du continent entre 2019 et 2023. Les EAU sont plus présents au niveau de l’Afrique de l’Est, et pour ce qui concerne l’Afrique Atlantique, leurs motivations seraient de contrôler des sites stratégiques en océan Atlantique et de renforcer leur rôle logistique au niveau mondial. Elles sont impliquées dans la gestion des ports au Sénégal, en Angola, et avec un projet en cours de réalisation au Congo.
Depuis 2010, la Russie a intensifié ses échanges commerciaux avec l’Afrique, en ciblant en priorité les secteurs stratégiques de l’armement et de l’énergie, qui impliquent directement les principaux acteurs des régimes russe et africains. Parallèlement, les entreprises russes ont investi dans les industries extractives notamment les mines, le pétrole et le gaz, ainsi que dans les infrastructures associées, afin de faciliter le transport et l’exportation de ces ressources. L’imposition de sanctions occidentales a toutefois entraîné un déclin des activités russes sur le continent et le retrait de certains projets. Néanmoins, l’intérêt économique de Moscou pour l’Afrique ne s’est pas estompé ; la Russie tend désormais à se redéployer autour de nouveaux axes, en particulier le développement de projets portuaires, comme ceux initiés à Lagos et à Dakar. Parmi les projets annoncés pour 2025, figure le lancement d’une liaison maritime directe entre Novorossiïsk et Lagos, destinée à offrir de nouveaux débouchés aux exportations russes. Enfin, si les investissements russes ont globalement reculé, les échanges pétroliers entre la Russie et l’Afrique subsaharienne ont, quant à eux, progressé. Ce dynamisme s’explique par le plafonnement des prix imposé par les sanctions occidentales, qui a permis à la Russie de gagner des parts de marché en Afrique.
La Turquie suit une logique différente en multipliant ses interventions via des concessions ou des partenariats public-privé (PPP) dans les secteurs aéroportuaires et d’équipements publics, renforçant ainsi la présence de ses entreprises privées au Sénégal, en Guinée et au Togo. L’Inde développe aussi ses échanges et ses investissements, surtout au Nigeria, au Ghana et au Sénégal, dans les secteurs des hydrocarbures, de l’agriculture, de l’industrie manufacturière et pharmaceutique, ainsi que dans le domaine des technologies de l’information, tout en renforçant ses partenariats commerciaux et de sécurité avec les organisations régionales.
À côté des États, des opérateurs privés étrangers jouent un rôle important en Afrique Atlantique, tels que MSC, Maersk, ou CMA CGM, avec des ambitions et des influences économiques et géostratégiques spécifiques. Si ces investissements contribuent à l’intégration des marchés mondiaux et à la mise à niveau des infrastructures, ils soulèvent aussi des questions de souveraineté économique et de durabilité, en rapport avec le contrôle des actifs stratégiques, le développement du contenu local, le respect de la transparence contractuelle et des normes environnementales et sociales, ainsi que l’assurance de la viabilité à long terme des infrastructures.
D’autre part, le potentiel maritime de la façade atlantique est menacé par des risques sécuritaires, telles que la piraterie, les trafics illicites et l’instabilité côtière qui freinent les investissements et accentuent la marginalisation de certains territoires. En effet, l’instabilité politique dans certains États d’Afrique de l’Ouest ou d’Afrique centrale, combinée aux activités des groupes armés djihadistes dans la bande sahélienne, crée un terreau favorable aux réseaux de trafiquants exploitant cette région. À titre d’exemple, le golfe de Guinée (du Sénégal à l’Angola) a constitué la dernière décennie la principale zone mondiale de piraterie maritime, avec des dizaines d’actes de piraterie, vols de cargaisons pétrolières et enlèvements chaque année, notamment au large du Nigeria, Bénin, Togo et région. Cette situation est d’autant plus préoccupante que les initiatives sécuritaires actuelles demeurent éparses, limitées dans leur portée, et insuffisamment coordonnées pour répondre à l’urgence des enjeux.
Dans un contexte marqué par la présence de plusieurs acteurs mondiaux, la CNUCED souligne que les flux conteneurisés en provenance de l’Afrique ne représentent que 5 % du total mondial. Parallèlement, selon Afreximbank (African Export-Import Bank) , le commerce intra-africain n’a constitué que 14,4 % du commerce total du continent en 2024. Ces chiffres modestes s’expliquent par plusieurs contraintes structurelles : la fragmentation des marchés, la multiplication des barrières non tarifaires, l’insuffisance et la discontinuité des infrastructures logistiques, ainsi que la faiblesse des bases industrielles. Ces obstacles limitent la transformation locale des produits, déplacent la création de valeur hors du continent et rendent les économies africaines particulièrement vulnérables aux chocs exogènes, notamment à la volatilité des prix mondiaux.
L’intégration des systèmes financiers en Afrique constitue également un enjeu stratégique pour la facilitation des échanges entre les pays africains. L’exemple de la plateforme PAPSS (Pan-African Payment and Settlement System), créée en 2022 par l’Afreximbank, illustre ce potentiel en visant à fluidifier les paiements transfrontaliers. Toutefois, des défis subsistent en matière d’interopérabilité technique, de confiance et d’adoption par les entreprises, d’harmonisation des cadres réglementaires entre les pays, ainsi que de prévention des risques liés à la cybersécurité et à la fraude.
Pourtant, plusieurs cadres structurants ont été instaurés pour renforcer l’intégration régionale, notamment à travers les CER, telles que la CEDEAO (Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest), qui étaient supposées jouer un rôle moteur dans ce processus. S’y ajoutent d’autres initiatives à l’instar de la Stratégie africaine intégrée pour les mers et les océans à l’horizon 2050 (AIM 2050), qui vise, entre autres, à stimuler le commerce intra-africain en zone maritime ou tout récemment la ZLECAF dont l’objectif est de créer à terme un marché unique pour les biens et les services. Cependant, la mise en œuvre de ces dispositifs tarde à produire les effets escomptés. Bien que la CEDEAO soit souvent présentée comme l’un des modèles les plus aboutis d’intégration régionale en Afrique, elle a été fragilisée en 2025 par le retrait simultané du Niger, du Mali et du Burkina Faso, sur fond de profondes divergences politiques. Cette situation soulève des interrogations quant au modèle de gouvernance le plus pertinent et à l’espace géographique le plus cohérent pour mener à bien une intégration économique régionale réussie, tout en préservant la souveraineté des États africains et en répondant aux impératifs d’accélération du développement du continent.
Au-delà des dimensions économiques, cette façade est aussi un espace de mémoire, profondément marqué par la traite atlantique et l’histoire coloniale, un espace que plusieurs penseurs africains, , invitent à reconsidérer. L’Atlantique n’est pas seulement un océan qui divise les continents, il est une interface de mémoire où se croisent les douleurs du passé et les espoirs pour un avenir meilleur et partagé. Il véhicule une histoire marquée par la séparation, mais aussi par la circulation des personnes, des cultures et des imaginaires. Ainsi, cet espace maritime devient un lieu de transformation, un espace d’interactions où les relations entre l’Afrique et le monde entier se réinventent continuellement, portant les traces d’une histoire commune mais aussi les promesses d’une nouvelle communauté à construire et de nouvelles ambitions à réaliser.
Conclusion
Le renouveau de l’Afrique nécessite des transitions africaines et un nouvel agenda africain pour accélérer le développement durable. Les défis de l’Afrique sont multiples et complexes. Il ne peut y avoir de réelles transformations sans leviers catalyseurs, et il ne peut y avoir de progrès soutenable sans solutions africaines. La géographie fait de l’Atlantique africain un axe de développement riche en ressources naturelles, bénéficiant d’un positionnement stratégique au niveau des routes maritimes et pouvant générer les leviers catalyseurs recherchés.
Réussir une telle transformation exige une appropriation partagée et une adhésion collective de l’ensemble des acteurs : États, secteur privé, société civile et populations. L’océan doit être envisagé comme un vecteur fédérateur, capable de porter des projets intégrateurs et de stimuler des interconnexions logistiques, énergétiques et portuaires. Une telle dynamique suppose également l’harmonisation des systèmes d’échange de données, des cadres réglementaires et des mécanismes de régulation, afin de créer un environnement propice aux échanges et à l’investissement. Elle requiert, en outre, des dispositifs financiers adaptés, appuyés par de nouveaux modèles de coopération et de gouvernance régionale.
Références
- Afreximbank (Banque africaine d’import-export). Le commerce africain dans un environnement financier mondial en mutation. Rapport phare sur le commerce africain 2025, Assemblées annuelles à Abuja, 26 juin 2025.
- Aurégan, Xavier. 2025. La présence économique chinoise en Afrique, quelles réalités ? Dossier régional « Afrique(s) : dynamiques régionales ». Géoconfluences. Publié le 14 avril 2025. Université catholique de Lille, Institut français de géopolitique.
- Barbosa, Pedro Henrique Batista. 2020; New Kids on the Block: China’s Arrival in Brazil’s Electric Sector. GCI Working Paper 012, Global China Initiative, Global Development Policy Center, Pardee School of Global Studies, Boston University,
- Biaggi, Catherine, et Laurent Carroué. 2020. Affirmer sa puissance : forces sous-marines et dissuasion nucléaire, enjeux géographiques et géostratégiques. Mis à jour en 2023. In Géoconfluences, Dossier « Océans et mondialisation ». Lyon : ENS de Lyon.
- Biaggi, Catherine, et Laurent Carroué. 2024. « Les grands détroits et canaux internationaux dans la géopolitique des mers et océans, un système très hiérarchisé sous tensions multiformes. » Géoconfluences.
- Bpifrance Le Lab. 2025. « Amérique latine : l’Union européenne et la Chine pourraient tirer parti de la politique agressive de D. Trump. » Le Lab (site web).
- Cattin, Thomas. 2025. « Carte commentée. Le Mexique, premier garde-frontière des États-Unis ? » Diploweb.com. https://www.diploweb.com/Carte-commentee-Le-Mexique-premier-garde-frontiere-des-Etats-Unis.html.
- CNUCED (Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement). 2025. Amérique latine : L’intégration régionale pour renforcer l’industrie verte et la résilience économique. https://unctad.org/fr/news/amerique-latine-lintegration-regionale-pour-renforcer-lindustrie-verte-et-la-resilience.
- CNUCED (Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (UNCTAD). 2023. « Data Insights : Maritime Transport – Containerized Port Traffic by Group of Economies, 2023. » UNCTADStat Data Hub.
- Commission de l’Union africaine. 2015. Agenda 2063 : L’Afrique que nous voulons. Addis-Abeba : Commission de l’Union africaine. https://au.int/fr/agenda2063.
- Da Rocha, Felipe Freitas, et Ricardo Bielschowsky. 2018. “China’s Quest for Natural Resources in Latin America.” Revista CEPAL 126. Commission Économique pour l’Amérique Latine et les Caraïbes (CEPAL). LC/PUB.2018/26-P.
- DSN Energy. 2025. “Renewable Energy Surge Puts Latin America on Track for Climate Leadership.” DSN Energy. https://www.dsnsolar.com/news/renewable-energy-surge-puts-latin-america-on-t-17468605399852032.html.
- El Houdaïgui, Rachid. 2023. “Atlantic Africa : United States, Europe, China, Russia. Influences with Variable Geometry – A View from the South.” In Atlantic Centre Report n.º 3: Great Power Competition in the Atlantic, 147–158. Lisboa: Atlantic Centre.
- European Commission. n.d. Towards the Atlantic European Transport Corridor: Overview Interviews. https://transport.ec.europa.eu/transport-themes/infrastructure-and-investment/trans-european-transport-network-ten-t/atlantic-corridor_en.
- Funaiole, Matthew P., Dana Kim, Brian Hart, et Joseph S. Bermudez Jr. 2022. “Eyes on the Skies : China’s Growing Space Footprint in South America.” Hidden Reach, Center for Strategic and International Studies.
- Hernandez-Roy, Christopher, Rubi Bledsoe, et Andrea Michelle Cerén. 2023. Tracking Transatlantic Drug Flows : Cocaine’s Path from South America Across the Caribbean to Europe. Washington, DC : Center for Strategic and International Studies. https://features.csis.org/tracking-transatlantic-drug-flows-cocaines-path-from-south-america-across-the-caribbean-to-europe.
- Hogan Lovells. 2025. “Chinese Investment Protection in Latin America : Navigating Regulatory Risks through Strategic Arbitration.” Lexology.
- International Organization for Migration (IOM). 2024. Migration irrégulière vers l’Europe . Flow from Western African Atlantic Route. IOM Displacement Tracking Matrix.
- Kéfi, Walid. 2025. “Le russe JSC A7 Holding lancera une route maritime directe vers l’Afrique de l’Ouest.” Agence Ecofin.
- Kerriou, A. 2025. « Conteneurs : classement 2024 des principaux ports mondiaux. » Market Insights – Analyse Transport & Logistique, Upply.
- Medina, Lucile. 2019. “Les projets de corridors interocéaniques en Amérique centrale : Échelles et enjeux.” EchoGéo 49.
- Ministerio de Economía, Fomento y Turismo (Chili). 2025. « Chile lanza Plan de Acción para concretar el Corredor Bioceánico Vial ».
- Myers, Margaret. 2023. “It’s Electric! : China’s Power Play in Latin America.” Weekly Asado (Wilson Center – Latin America Program Blog).
- Nairametrics Research Team. 2025. “Nigeria’s Top 10 Foreign Trade Partners in 2024.” Nairametrics. https://nairametrics.com/2025/03/14/nigerias-top-10-foreign-trade-partners-in-2024/.
- OMNEGY by EPSA. 2025. Le GNL américain, pierre angulaire du secteur gazier dans le monde. Policy Brief.
- Perrin, Francis. 2024. Bassin Atlantique : une zone très importante pour l’industrie des hydrocarbures. Policy Brief n° 70/24. Rabat : Policy Center for the New South.
- Schotte, Jonathan. 2024. « Relations Chine-Afrique : La Chine promet d’augmenter ses engagements financiers en faveur de l’Afrique lors du Sommet du Forum sur la Coopération sino-africaine. » Credendo.
- Soliman, Mohammed. 2024. “America Re-engages Africa and Latin America in a Reimagined Atlantic.” Foreign Policy Research Institute. https://www.fpri.org/article/2024/01/america-re-engages-africa-and-latin-america-in-a-reimagined-atlantic/.
- Tobi, Youssef. 2021. La maritimisation du monde et l’espace atlantique africain : quelle place pour le Maroc ? Policy Paper. Rabat : Policy Center for the New South.
- Torregrossa, Michaël. 2025. “Hydrogène vert : le Chili mise sur son potentiel naturel.” H2 Mobile.
- Union européenne. 2025. Communication conjointe au Parlement européen et au Conseil : Plan d’action de l’UE sur la sécurité des câbles. JOIN(2025) 9 final. Bruxelles,. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=JOIN:2025:9:FIN.
- Vial, Anne-Sophie, et Émile Bouvier. 2025. “Türkiye, the New Regional Power in Africa (2/3). A Turkish Economic Presence.”.
- Vircoulon, Thierry. 2025. « Les effets contradictoires des sanctions occidentales sur les relations économiques russo-africaines. » Ifri, Centre Afrique subsaharienne.